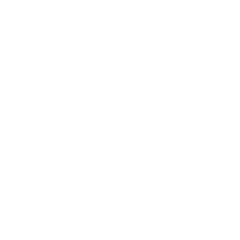Dans un contexte où les verbes «s’engager» et «militer» semblent détournés de leur signification première, Johan Faerber nous invite à redécouvrir la véritable essence de l’engagement politique et social. À travers son ouvrage Militer, verbe sale de l’époque, il retrace les évolutions historiques et contemporaines du militantisme, en soulignant les répressions auxquelles sont confronté·es les militants et militantes aujourd’hui. Invité par la Maison poème où il s’entretenait avec la journaliste Charline Cauchie à propos de son livre, il partage ses réflexions inspirantes pour qui croit en la force du changement collectif.
Dans un contexte où les verbes «s’engager» et «militer» semblent détournés de leur signification première, Johan Faerber nous invite à redécouvrir la véritable essence de l’engagement politique et social. À travers son ouvrage Militer, verbe sale de l’époque, il retrace les évolutions historiques et contemporaines du militantisme, en soulignant les répressions auxquelles sont confronté·es les militants et militantes aujourd’hui. Invité par la Maison poème où il s’entretenait avec la journaliste Charline Cauchie à propos de son livre, il partage ses réflexions inspirantes pour qui croit en la force du changement collectif.
Propos recueillis par Stéphanie Baudot
Quel est l’élément déclencheur qui vous a donné l’envie d’écrire ce livre sur le militantisme?
L’envie d’écrire ce livre provient d’un constat répété: de nos jours, l’engagement est omniprésent. On le retrouve partout, des produits «engagés» dans les supermarchés aux campagnes promotionnelles incitant à des actions responsables, comme réparer son vélo ou customiser ses chaussures pour leur donner une seconde vie. Dans le monde de l’entreprise, le terme «engagement» est aussi largement utilisé à la fois pour désigner l’implication des employé·es et leur loyauté envers l’entreprise. De plus, les entreprises encouragent la participation à des activités caritatives annexes à l’entreprise, considérant l’engagement comme une plus-value mesurable en compétences et valorisable dans la grille salariale. Ce phénomène est assez nouveau et symptomatique du dévoiement du terme «engagement».
Je me suis alors interrogé sur ce glissement de sens du mot «engagement» qui renvoie à un sens très précis, défini par Sartre en 1947 concernant la littérature engagée: un engagement absolu, une quête d’idéal, un combat. L’engagement, par définition, implique un certain désintéressement, une dévotion à une cause.
S’engager, c’est enlever toute dimension politique à l’acte même de s’engager.
Vous pointez alors une sorte de divorce sémantique entre les termes d’engagement et de militantisme...
Je me suis en effet rendu compte que le mot «engagement» s’était vidé de sa substance militante pour devenir la version morale d’un militantisme désormais perçu comme immoral. Ces termes autrefois synonymes sont à présent devenus presque antonymes. S’engager, c’est enlever toute dimension politique à l’acte même de s’engager. C’est une stratégie d’apolitisme intense managériale qui vise uniquement à marginaliser les militant·es, à les stigmatiser.
À contrario, le verbe militer devient le mot noir de l’époque: le verbe honni, le verbe de l’opprobre, de la déconsidération, voire de la déchéance sociale. Cela s’apparente à une confiscation de la citoyenneté, qui invalide toute position dans un échange social. Dans mon livre, j’exemplifie ce constat entre autres avec la répression brutale qu’ont subie les militant·es écologistes à Sainte-Soline le 25 mars 2023. Ce jour-là, les forces policières ont tiré une pluie de projectiles (5.000 par heure) sur les militant·es qui protestaient pacifiquementcontre la construction de méga-bassines de rétention d’eau, dénonçant l’accaparement de l’eau par les grands producteurs agricoles. Cette répression violente a fait 42 blessé·es, dont plusieurs graves.
À travers cet épisode de Sainte-Soline, vous montrez aussi que les armes utilisées pour disqualifier le militantisme sont à la fois juridiques et discursives. Pourriez-vous expliquer?
Exactement. On voit opérer dans cet évènement une double mutilation: physique, avec des blessures graves, et morale, en discréditant le discours des militant·es, en rendant le combat militant impropre. Il faut en quelque sorte faire passer aux militant·es l’envie de militer. La répression morale à laquelle on assiste à Sainte-Soline s’appuie sur la notion d’« écoterrorisme», un concept américain des années 1980, utilisé par le discours néolibéral pour fabriquer des «non-citoyen·nes». En France et en Belgique, le terme «terrorisme» porte une forte connotation de honte sociale et d’hyperdélinquance.
Appliquer les dispositions antiterroristes à de simples militant·es écologistes en bottes de pluie et coupe-vent est donc une manière de les disqualifier, de les stigmatiser et de les criminaliser. Cela rejoint la rhétorique d’extrême droite sur l’ennemi intérieur, une sorte de cinquième colonne invisible qui viendrait tout détruire.
Comment s’est opéré ce glissement de vision du militantisme au cours de l’histoire?
Je distingue en fait trois âges différents du militantisme: l’âge des militant·es, l’âge du militantisme et celui du postmilitantisme. L’âge des militants commence en 1830 et se poursuit jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. En France, deux figures professionnelles du militant émergent alors: le prêtre ouvrier, représentant la fraternité, le partage, la salissure et le militant communiste, incarnant l’héroïsation, l’idéalisation et le désintéressement. Ces figures partagent un caractère sacrificiel. Le prêtre ouvrier est vu comme la grande figure politique du militant, car il se confronte aux ouvriers, à la matière même, et à la difficulté de se faire entendre, tandis que le militant communiste est perçu comme une figure romantique, animée par une énergie et une fougue face aux injustices. L’alliance des deux, le prêtre ouvrier et le militant communiste apporte à la fois le politique et le romantique. Cette combinaison a fait du militant un personnage central de la scène politique, non seulement en France, mais aussi en Europe.
Le capitalisme est souvent perçu comme un hyper péché structurel, une forme d’égoïsme contre lequel ces deux figures luttent ensemble. Avec le temps, le capital militant s’est effrité et nous sommes entrés dans l’âge du militantisme, où le militant, la militante, s’est professionnalisé·e au sein d’organisations et d’associations. Le terme «militantisme» apparait en 1962, désignant une activité liée à une profession, comme enseignant militant, ouvrier militant ou encore écrivain militant. Enfin, l’âge du post-militantisme qui s’ouvre dans les années 1990 voit une démobilisation syndicale et une criminalisation des militant·es.
Parler de militant·es d’extrême droite est donc un contresens absolu, un abus de langage, un oxymore. Il n’y a pas de militant·es d’extrême droite, seulement des militaires d’extrême droite.
Comment définiriez-vous alors le militantisme, notamment dans le contexte actuel de crise démocratique?
«Militer» est apparu au 16e siècle comme un verbe dérivé de «militaire» qui signifie l’enrôlement et l’embrigadement. Mais en 1794, avec la Révolution française qui démilitarise son usage, il prend un nouveau sens. Militer renvoie à des moyens pacifiques pour promouvoir des idées démocratiques. Militer signifie lutter pour la démocratie, la justice et l’équité. Tant qu’il y a des militant·es, cela signifie que la démocratie n’est pas pleinement réalisée. Le militant, la militante, est donc celui ou celle qui se bat pour que la démocratie ne soit ni un élément de langage ni un vague idéal-type existant dans le monde des idées. Pour moi, il n’existe d’ailleurs qu’un militantisme tourné vers le progressisme, la justice sociale, les idées. Parler de militant·es d’extrême droite est donc un contresens absolu, un abus de langage, un oxymore. Il n’y a pas de militant·es d’extrême droite, seulement des militaires d’extrême droite.
Selon moi, le verbe « nuancer » est problématique, car il est souvent utilisé pour réduire au silence les victimes, à l’instar de ce qu’on voit à l’égard de mouvements comme #MeToo. Cette nuance devient un nouvel outil du patriarcat pour discréditer la parole des victimes et semer le doute.
Vous opposez aussi la figure du militant à celle de l’électeur. Pourquoi? Quelles sont les différences entre les deux?
La presse et l’électeur sont apparus au 19e siècle pour empêcher l’expression populaire. L’électeur est l’antithèse de l’insurgé, représentant la raison face à la déraison de la rue. L’institutionnalisation progressive de l’élection, en tant que délégation politique, est pour moi une évolution négative. La presse, quant à elle, a multiplié les tribunes à partir des années 1830, confisquant la parole de la rue. Ce n’est pas un hasard si la presse était vendue dans la rue, car elle opposait une parole écrite à une parole orale expressive et revendicative. Je crois que cela constitue le cœur du dispositif antimilitant. Tout cela me fait réfléchir à la manière dont les journalistes conçoivent les choses. Selon moi, le verbe « nuancer » est problématique, car il est souvent utilisé pour réduire au silence les victimes, à l’instar de ce qu’on voit à l’égard de mouvements comme #MeToo. Cette nuance devient un nouvel outil du patriarcat pour discréditer la parole des victimes et semer le doute.
Dans votre livre, vous abordez aussi la fin supposée du concept de «lutte des classes» à la faveur de celui de «classes moyennes». Il n’en est rien selon vous?
En effet, la lutte des classes n’a jamais disparu. En Italie, par exemple, tout le monde se croit de la classe moyenne, un terme flou qui masque la réalité des classes sociales. Ce type de concept est très informe et empêche d’adopter une position plus revendicative, car il n’y a pas de conscience de classe. Cette hétérogénéité empêche également la solidarité, car elle est trop disparate. Cette hétérogénéité est en réalité fabriquée sous couvert de concepts unificateurs. Ce sont de faux concepts, des fictions du capital visant à diviser et à casser les solidarités.Le management, en ce sens, est une contrerévolution. Son objectif est de fragmenter et de neutraliser les mouvements solidaires et revendicatifs.
Vous êtes critique à l’égard de la littérature. Vous dites notamment qu’elle participe à la stigmatisation du militant. Quel est le rôle de la littératurepar rapport à l’engagement?
Je pense que le rôle de la littérature est double, comme j’essaie de l’expliquer dans cet essai. D’une part, de manière un peu étonnante, elle est coupable parce qu’elle est instrumentalisée par certain·es comme une puissance antimilitante qui empêche de militer, produisant ainsi une forme d’amnésie sociale. Il existe une part de la littérature qui n’est pas de divertissement, mais qui se présente comme une littérature engagée et qui, paradoxalement, produit une fonction d’effacement. Par exemple, dans le roman Connemara de Nicolas Mathieu, on voit une situation de détresse d’une jeune femme au travail. Elle ne mobilise pas les outils qu’elle pourrait utiliser pour militer. Au contraire, l’intrigue se résout autour d’une question personnelle et psychologique. L’héroïne est en burn-out, et bien qu’elle soit décrite comme constamment en colère, cette colère n’est absolument pas transformatrice. Ce n’est pas un roman politique, mais ce que j’appelle une littérature sentimentale.
D’un autre côté, il existe une littérature extrêmement forte qui ne se revendique pas politique, mais qui fait politiquement de la littérature. Elle essaie de reconstituer deux choses à la fois: proposer des fables pour imaginer un autre monde, pas forcément une utopie, mais concrètement, en illustrant comment recréer du lien. Cela peut être l’œuvre de Nathalie Quintane, Emma Marsantes, Tanguy Viel, Stéphane Bouquet ou Laurent Mauvignier. Cette littérature appelle à faire commun, à ne pas considérer que la communauté est quelque chose de donné, mais à comprendre qu’elle doit être construite pas à pas. C’est une littérature dont la vocation est démocratique, qui a compris que la démocratie ne doit pas demeurer un simple élément de langage, mais doit être construite jour après jour. C’est une littérature modeste qui mesure la difficulté de construire une démocratie au quotidien.
Comment redonner un nouveau souffle au verbe militer?
Ce que j’essaie de montrer dans le livre, c’est qu’il faut sortir le militantisme de sa gangue mythifiée et héroïque. Militer, c’est trouver les conditions possibles pour pouvoir discuter, c’est créer un espace de dialogue. C’est très compliqué au quotidien. Travaillant dans un lycée, je me rends compte que trouver l’action et convaincre les gens de s’y engager est une entreprise extrêmement difficile. Quand on a milité soi-même, on sait qu’il faut être extrêmement modeste et précautionneux. Cela prend énormément de temps et d’effort.
Militer, c’est trouver les conditions possibles pour pouvoir discuter, c’est créer un espace de dialogue. C’est très compliqué au quotidien.
Débattre, c’est autre chose. Les forces en place se présentent comme des défenseurs du débat pour stigmatiser les militant·es, les décrivant comme incapables de dialoguer. En réalité, le débat n’a jamais lieu; c’est un élément de langage. Le débat doit se faire entre nous, pour permettre d’affiner notre sensibilité et de préciser collectivement des problématiques sur lesquelles on est déjà d’accord. Il ne doit pas se faire avec nos adversaires, notamment l’extrême droite. Avec eux, aucun dialogue n’est possible. Le dialogue est très compliqué, tout comme la démocratie. Il ne suffit pas d’être disponible pour un café pour dialoguer réellement, car ces échanges se font sur une base d’asymétrie de pouvoirs et d’objectifs.
Militer dans ce contexte peut devenir démobilisateur ou épuisant. On parle aujourd’hui de burnout militant. Les militant·es doivent pallier les carences de l’État tout en étant déconsidérés par lui. Comment faire pour sortir de ce cercle dévastateur?
La seule solution qui parait possible est précisément de «s’en sortir par le bas» comme le clame Emma Marsantes. Produire une parole qui tienne compte résolument des situations, qui évalue les risques et ouvre chacune et chacun à une action qui permette de ne plus être des victimes narratives du néolibéralisme. On est fatigué par le néolibéralisme, il veut même faire du militantisme une zone d’épuisement, mais les idées sont toujours plus fortes que le corps: un jour ou l’autre, elles triomphent. C’est la raison d’être du militantisme lui-même: son caractère propre, si j’ose dire. #
Johan Faerber, MILITER Verbe sale de l’époque, Editions Autrement, coll « Haut et fort », 2024, 259 p., 20 €