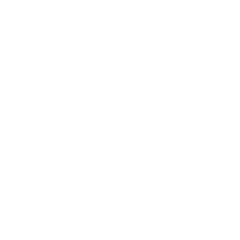Depuis la révolution de Maïdan à Kiev en février 2014 et l’invasion de l’Ukraine en 2022, les hommages à Staline se sont multipliés en Russie. L’intérêt du public pour l’histoire du Goulag a lui aussi augmenté. Selon l’auteur Nikolaï Epplé, la société russe doit se soigner d’un traumatisme collectif pour se libérer de la fausse emprise de l’histoire.
Depuis la révolution de Maïdan à Kiev en février 2014 et l’invasion de l’Ukraine en 2022, les hommages à Staline se sont multipliés en Russie. L’intérêt du public pour l’histoire du Goulag a lui aussi augmenté. Selon l’auteur Nikolaï Epplé, la société russe doit se soigner d’un traumatisme collectif pour se libérer de la fausse emprise de l’histoire.
En mille neuf cent quarante-neuf, nous tombâmes, quelques amis et moi, sur une note remarquable publiée dans une revue de l’Académie des Sciences, La Nature.En mille neuf cent quarante-neuf, nous tombâmes, quelques amis et moi, sur une note remarquable publiée dans une revue de l’Académie des Sciences, La Nature.Il y était rapporté en petits caractères, qu’à l’occasion d’une campagne de fouilles dans le bassin de la Kolyma, on avait un jour découvert une lentille de glace souterraine, témoin d’un courant ancien pris par le gel, et, dans ce courant, pris eux aussi par le gel, des représentants d’une faune fossile remontant à plusieurs dizaines de milliers d’années. Poissons ou tritons, ils s’étaient conservés dans un tel état de fraîcheur, au témoignage du savant correspondant de la revue, que les participants, cassant la glace qui les enveloppait, les avaient mangés sur-le-champ avec plaisir.Le petit nombre de lecteurs que compte cette revue durent sans doute n’être pas peu étonnés d’apprendre que la chair de poisson était capable de se conserver si longtemps dans la glace.
Mais bien moins nombreux encore furent ceux qui purent pénétrer le sens véritable et grandiose de cette note imprudente.Nous, nous comprîmes sur-le-champ. Nous vîmes d’un coup toute la scène, jusque dans ses moindres détails : les participants cassent la glace avec une précipitation forcenée ; foulant aux pieds les sublimes intérêts de l’ichtyologie, jouant des coudes, ils dépècent cette chair millénaire, la traînent jusqu’au feu, la dégèlent et se rassasient.Si nous avions compris, c’est que nous étions nous-mêmes de ces participants, que nous étions membres de cette puissante tribu des zeks, la seule sur cette terre à être capable de manger du triton avec plaisir.
Quant à la Kolyma, c’était l’île la plus importante, la plus célèbre, le pôle de férocité de cet étonnant pays du Goulag, déchiqueté par la géographie, tel un archipel, mais soudé par la psychologue, tel un continent, de ce pays quasi invisible, quasi impalpable, où habitait précisément le peuple des zeks.Cet archipel formait dans l’autre pays, qui l’englobait, toute une marqueterie d’enclaves, il enfonçait des coins dans ses villes, il était en suspension au-dessus de ses rues – et pourtant certains n’en avaient pas la moindre idée, un très grand nombre avaient entendu parler de quelque chose, mais vaguement, seuls ceux qui y avaient séjourné savaient tout.
Mais, comme si d’avoir vécu sur les îles de l’Archipel les avait privés de l’usage de la parole, ils gardaient le silence.Un tournant inattendu de notre histoire a fait que quelques petites choses touchant cet Archipel – infiniment peu – ont été rendues publiques. Mais les mêmes mains qui naguère nous bouclaient les menottes aux poignets se tendent aujourd’hui vers nous, conciliantes, les paumes ouvertes : « Non !... Il ne faut pas remuer le passé !... Du passé qui parlera, on l’éborgnera ! » Mais le proverbe s’achève ainsi : « Le passé qui oubliera, on l’aveuglera ! »
Telles sont les premières lignes de l’œuvre incontournable d’Alexandre Soljenitsyne 1 (1918-2008), L’Archipel du Goulag écrit en 1973. Aujourd’hui, la métaphore du poisson primitif gelé symbolise ce que les spécialistes appellent la mémoire collective. L’un d’entre eux, l’historien Nikolaï Epplé 2, utilise ce passage pour symboliser la façon dont la mémoire de la terreur sous Joseph Staline est traitée dans la Russie contemporaine : il s’agit d’un « morceau de glace, préservant une expérience vécue, qui reste néanmoins étrangère et inaccessible pour beaucoup », écrit-il dans Die unbequeme Vergangenheit (Le passé inconfortable). Dans ce livre écrit en russe et récemment traduit en allemand, il cherche à comprendre pourquoi la mémoire de la terreur stalinienne est restée à ce point intacte.
« J’ai eu l’idée d’écrire ce livre alors que je travaillais pour un journal économique russe, l’un des derniers journaux indépendants du pays. Depuis les manifestations électorales de 2013 jusqu’à l’annexion de la Crimée, la période était très intense, et la question de la mémoire collective revenait sans cesse », explique Nikolaï Epplé. « Je me suis rendu compte qu’il était largement admis que le passé stalinien était un obstacle à notre progression vers une société plus libre. Mais en travaillant sur ce livre et en discutant avec des experts, des fonctionnaires, des militants et des hommes d’affaires, j’ai réalisé qu’il ne s’agissait pas seulement de mots et de rhétorique, mais de quelque chose de concret : l’héritage de la dictature stalinienne, avec ses systèmes décisionnels et politiques caractérise encore aujourd’hui la Russie, en particulier au sein de l’État, mais aussi dans la société en général, comme en témoigne la façon dont les gens communiquent avec l’État et le faible niveau de confiance qu’ils lui accordent. »
Une « guerre des mémoires »
La question de la mémoire collective liée à la terreur stalinienne a gagné en importance au cours de ces dix à quinze dernières années. Cette évolution s’inscrit dans un contexte dans lequel les dirigeants politiques russes ont progressivement adopté une position de plus en plus expansionniste à l’égard des pays voisins de l’ancienne sphère soviétique. L’expression « guerre des mémoires », longtemps réservée aux universitaires, est, depuis le début des années 2010, largement utilisée pour décrire cette nouvelle réalité.
« Les journaux télévisés regorgent de reportages sur l’inauguration, la profanation ou la démolition de monuments à la gloire de Staline, d’Ivan le Terrible ou du prince Vladimir. Ils couvrent aussi les musées ou les mémoriaux consacrés à tel ou tel personnage historique. La dernière initiative visant à rebaptiser Volgograd en Stalingrad a également suscité leur attention. Les sondages révèlent que les sympathies pour Staline atteignent sans cesse de nouveaux records », écrit Epplée.
Un sondage d’opinion, réalisé en 2019, révèle en effet que 51 % des personnes interrogées ont une opinion favorable envers Staline et 70 % pensent que Staline a joué un rôle positif dans l’histoire de la Russie, ce qui est le score le plus élevé depuis 2001 3. En même temps, dans la culture populaire, les bandes dessinées sur Staline et le Goulag sont devenues immensément populaires.
Selon Nikolaï Epplé, l’histoire a remplacé la politique actuelle comme principal sujet de discussion des Russes. Ce n’est pas le présent, mais la Première et la Seconde Guerre mondiale, l’Afghanistan, la Tchétchénie, le stalinisme et la dissolution de l’Union soviétique qui font l’objet de débats dans les rues, sur les places et dans les cuisines, en dépit du fait que la croissance économique est à la traine et que le pays est engagé depuis dix ans dans une guerre larvée avec l’Ukraine, qui, depuis la publication du livre de Nikolaï Epplé, s’est également transformée en une guerre ouverte d’invasion.
Parmi les sujets historiques à la mode, aucun n’est aussi populaire que Staline, surtout depuis le déclenchement du conflit avec l’Ukraine. Après la dissolution de l’Union soviétique, des statues occasionnelles ont commencé à apparaitre ci et là, mais elles étaient souvent cachées dans des écoles et des cours. Depuis le début de l’année 2014, elles ont été placées sur des places ouvertes et le long d’avenues. En février 2015, une sculpture représentant Staline, Churchill et Roosevelt a été érigée à Yalta, devenant la première statue officielle de l’ancien dictateur installée par l’État russe depuis la déstalinisation dans les années 1950.
Les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi ont revitalisé le nationalisme russe. Mais l’Euromaïdan 4 en Ukraine a mis en péril le projet post-impérial. L’annexion de la Crimée et le déclenchement de la guerre par procuration dans l’est de l’Ukraine ont fait apparaitre les fissures qui ébrèchent la construction de la nation russe. Selon Nikolaï Epplé, pour maintenir la cohésion de la nation et légitimer les politiques néo-impérialistes, un nouveau langage à la fois patriotique et universaliste était nécessaire. L’héritage de Staline et la victoire contre le Troisième Reich lors de la « Grande guerre patriotique » étaient alors les plus mobilisés par le régime en place.
« Après l’annexion de la Crimée en 2014, le Kremlin s’est mis en quête d’un symbole capable de renforcer l’image de l’État comme puissance et d’inspirer la peur à la population. Il s’agit d’une sorte de dictature numérique qui n’a plus besoin de recourir à la terreur physique. Dans ce nouveau conflit avec l’Occident, Staline et le stalinisme sont utilisés comme symboles, et l’idée d’ennemis intérieurs – qualifiés d’« agents occidentaux 5» – trouve ses racines dans les politiques de Staline », explique l’historien.
Le retour de Vladimir Poutine à une politique étrangère expansionniste a rapproché l’ère stalinienne de la situation actuelle. Sans reprendre explicitement la propagande stalinienne, le régime a commencé à s’inspirer de ce langage. Les ennemis extérieurs et intérieurs, les brigades punitives, les partisans de Bandera et les traitres sont devenus des éléments récurrents de la rhétorique de l’État. Contrairement à l’Union soviétique, le régime russe actuel n’a cependant aucune vision positive de l’avenir à offrir à ses citoyens et citoyennes. Son rôle de puissance subordonnée dans un système mondial signifie qu’il ne peut pas tenir ses promesses de restaurer la Russie en tant que superpuissance mondiale. En conséquence, l’histoire joue un rôle encore plus important dans la propagande d’État : au lieu de se tourner vers une nouvelle ère de grandeur, les Russes doivent revenir à une gloire révolue. En outre, cette dynamique s’est renforcée d’elle-même et s’est, dans une certaine mesure, découplée du contrôle de l’État. « Il s’est avéré que la société ne voulait plus seulement être terrorisée. Des décennies de croissance économique avaient donné aux citadin·es le sentiment d’être des citoyen·nes, des sujets indépendants. Cette tentative d’intimidation des personnes liées à Staline n’a pas suscité la peur, mais un intérêt accru pour le passé et l’histoire du goulag. »
La mémoire du Goulag
Depuis 2014, les livres sur le système du Goulag connaissent un succès considérable. Ce qui autrefois n’intéressait que les proches des victimes de la terreur stalinienne suscite désormais un intérêt général. C’est ainsi, selon Nikolaï Epplé, que l’engouement pour les études sur la mémoire qui a vu le jour en Europe dans les années 1980 et 1990 a gagné la Russie, et qu’il a trouvé un écho non seulement auprès des intellectuel·les, mais aussi du grand public. Le livre d’Epplé, qui a remporté le prestigieux prix russe Prosvetitel du meilleur livre de non-fiction en 2021, est l’expression de cette tendance. « Le succès de mon livre est dû à ce phénomène de deux manières. D’abord, il explique comment la mémoire du Goulag est liée à tous les problèmes qui ont caractérisé la Russie dans les années 1980 et 1990. Ils sont devenus intéressants pour une nouvelle génération qui n’avait pas lu Soljenitsyne. Il fallait donc que quelqu’un rende cette littérature déjà existante disponible dans une nouvelle langue. La publication du livre a également coïncidé avec des processus qui ont rendu ces sujets encore plus actuels. »
La deuxième raison est la guerre. Le prix Prosvetitel lui a été décerné avant le déclenchement de la guerre, mais il est évident que les processus menant à la guerre battaient déjà leur plein. « Après le déclenchement de la guerre, les gens avaient besoin d’un moyen de traiter le fait qu’ils étaient citoyens d’un État criminel. À quoi cela ressemble-t-il ? Comment y faire face ? Il n’existe pas de littérature russe sur ce sujet. D’une certaine manière, mon livre tente de répondre à ces questions. »
Quelle mémoire des victimes ?
Une grande partie de Die unbequeme Vergangenheit (Le passé inconfortable) est consacrée à la comparaison du cas russe avec d’autres États au passé sombre et la manière dont ils ont géré leur histoire. L’Allemagne, l’Argentine, l’Espagne, la Pologne, l’Afrique du Sud et le Japon servent de miroirs à travers lesquels l’expérience spécifique de la Russie est mise en lumière. Selon Nikolai Epplé, deux aspects distinguent la Russie des autres pays :
« La première est la durée. Le nazisme a duré douze ans en Allemagne. L’Union soviétique a existé pendant 70 ans. Et avant cela, il y avait aussi des dictatures. Il s’agit là d’un lourd héritage. Le deuxième facteur réside dans la difficulté de distinguer les victimes des auteurs. En Allemagne, cette distinction est aisée à établir, mais en Union soviétique, elle s’avère plus ardue, car il n’existe pas de groupe spécifique de victimes. Par exemple, pendant la terreur de 1937-1938, la violence était principalement dirigée contre les membres de la nomenklatura communiste. Étaient-ils seulement des victimes ou également des auteurs ?
Il est difficile de le dire. C’est là que réside la source de tous les problèmes lorsque l’on parle de mémoire. Lorsqu’un groupe de victimes est facilement identifiable, des mécanismes efficaces peuvent se mettre en place pour traiter la mémoire. Par exemple, dans le cas des Juifs et de l’Holocauste. Mais il est difficile de construire une mémoire des victimes en Russie parce qu’il n’y a pas de critères clairs ou de caractéristiques communes. Dans le livre, je mentionne plusieurs exemples de familles dont l’un des grands-pères était un bourreau et l’autre une victime. Il existe de nombreux exemples de ce type en Russie. »
En outre, si la distinction entre les victimes et les bourreaux est si difficile, c’est aussi parce qu’il nous manque cruellement d’information (sur les noms concrets de personnes), les archives sont éparses et dans la plupart des cas sont toujours inaccessibles au public. Nombreuses sont les familles qui ne savent pas raconter leur histoire au-delà de la troisième génération. Le passé reste donc caché – ce qui contribue par ailleurs à la possibilité de faire appel à la figure de Staline – , mais tout aussi traumatisant. On sait aujourd’hui qu’au moins 19,5 millions de personnes ont été victimes de la dictature (condamné·es innocemment, envoyé·es au Goulag, privé·s de leurs maisons et de leurs familles, etc.), mais l’État russe n’a jamais confirmé ces chiffres et ne s’est jamais excusé.L’aspect comparatif est important, car l’intérêt croissant pour l’histoire du Goulag est principalement discuté comme un cas unique, sans analogie. La seule comparaison qui est généralement faite est celle avec l’Allemagne nazie, qui a été vaincue. « Or, l’Allemagne est un mauvais exemple. C’est comme lorsqu’un élève a des difficultés à l’école et que ses parents lui disent de suivre l’exemple d’un meilleur élève. Pour la Russie, l’Allemagne est un exemple de réussite. Mais les Russes n’en sont que moins motivés, car ils se rendent compte que leur cas est plus désespéré qu’ils ne le pensaient. »
« L’exemple allemand est tout à fait unique, comme beaucoup l’ont déjà souligné. Le pays n’a pas seulement été vaincu, il a aussi été démantelé après la guerre. Il y a eu une transition politique avec un soutien conséquent des autres pays occidentaux. En général, la transition entre l’ancien et le nouveau régime est négociée. Souvent, les mêmes personnes restent au pouvoir après la transition. C’est pourquoi un processus de vérité et de réconciliation comme celui de l’Afrique du Sud est plus pertinent pour la Russie que ce qu’on peut appeler “ le modèle de Nuremberg ”, qui a été imposé à l’Allemagne. »
Nikolaï Epplé met aussi l’accent sur les problèmes qui se sont posés en Allemagne lors de la transition du nazisme. Bien que la dénazification ait été imposée au pays de l’extérieur, ce n’est que dans les années 1960 que la véritable transition a débuté dans la conscience collective. C’est alors que le processus a réellement commencé de manière efficace, après une période de « silence thérapeutique » qui, selon lui, est un phénomène récurrent après les traumatismes nationaux. Si la transition mentale n’a pas été le résultat du modèle imposé de Nuremberg, mais est venue des Allemands eux-mêmes, cela signifie-t-il que la Russie peut également connaitre un processus similaire ?
« Les transitions dépendent d’une combinaison de facteurs. Souvent, elles se produisent parce que les dictatures sont des systèmes de gouvernance inefficaces. On pourrait se demander si l’effondrement de l’Union soviétique a été forcé ou s’il est le résultat de processus internes. Il est difficile de répondre à cette question. »
Toutefois, Nikolaï Epplé souligne qu’il n’existe pas de solution unique applicable à tous les pays. Il s’agit plutôt de prendre des éléments des cas existants de transitions réussies et de les adapter aux conditions locales. Tant que la question de savoir qui est victime et qui doit être considéré comme coupable n’est pas résolue,il est difficile d’appliquer directement un modèle différent. Selon Epplé, la société russe doit suivre une sorte de version collective de la thérapie freudienne du traumatisme pour parvenir à une telle position.
« C’est le sujet de mon prochain livre. Il porte sur les transitions et j’analyse différents cas de réconciliation entre les victimes et les auteurs. Il est important de comprendre comment ces mécanismes au niveau individuel correspondent au niveau collectif. »
Le risque de la réconciliation est toutefois que la justice soit reléguée au second plan.« L’exemple sud-africain, qui mettait l’accent sur le pardon, a été très important au niveau international. Il a eu plusieurs effets positifs. Mais lorsque le pardon devient une idéologie d’État, de nouveaux problèmes apparaissent. Il existe une abondante littérature sur les réactions négatives qui surviennent dans de tels cas », explique Nikolaï Epplé, avant de poursuivre : « Le modèle de la thérapie des traumatismes est utile au niveau individuel et familial pour séparer la culpabilité de la responsabilité. Pour savoir comment séparer les infractions punissables des choses dont on peut même être fier. Pour la Russie, il ne s’agit pas d’affirmer que toute la période soviétique a été criminelle, mais il ne s’agit pas non plus d’affirmer qu’elle a été héroïque. Nous devons parvenir à un consensus national sur le fait que des crimes ont été commis et qu’ils doivent être punis. Mais cela ne signifie pas qu’il faille rejeter l’ensemble de l’histoire soviétique. Certaines parties peuvent constituer la base d’une identité positive. C’est là que la thérapie des traumatismes peut être utile, parce qu’elle aide les gens à analyser leur passé d’une manière qui ne les écrase pas. »
Selon Nikolaï Epplé, il y a tout de même un côté positif au cas russe, à savoir que le régime actuel n’a pas les mécanismes de survie dont ont besoin les dictatures ou les régimes totalitaires.« Tout d’abord, la dictature de Poutine manque d’une vision positive de l’avenir. Tout ce qu’elle peut offrir, ce sont des images du passé. Ainsi, ces drapeaux rouges, la solidarité avec les vétérans de guerre, les mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale sont piégés dans le passé. Cela me donne l’espoir que ce à quoi nous assistons aujourd’hui constitue le dernier souffle du dragon. Peut-être que la nécessité d’aborder véritablement le passé augmentera après l’effondrement du régime, qui, je l’espère, se produira dans un avenir pas trop lointain », ajoute-t-il en concluant :« Mais ce n’est que de la spéculation. De nombreuses personnes qui ont fui la Russie en 1917 pensaient la même chose que moi aujourd’hui.» #(*)
Jonas ELVANDER, journaliste responsable de la rubrique internationale pour la revue suédoise Flamman et chercheur en histoire à l’European University Institute de Florence
© stafichukanatoly / pixabay
1. Alexandre Isaïevitch Soljenitsyne (11 décembre 1918 - 3 août 2008) est un écrivain russe et l’un des dissidents les plus célèbres du régime soviétique pendant les années 1970 et 1980. Son premier roman, Une journée d’Ivan Denissovitch, publié en 1962, a révélé l’existence des camps de travail en URSS et a eu un impact considérable. Soljenitsyne a également écrit L’Archipel du Goulag, une chronique minutieuse du système de répression politique en Union soviétique, qui est considérée comme l’un des ouvrages majeurs du XXe siècle sur le système concentrationnaire et a contribué à la sensibilisation mondiale sur la répression politique et le système pénitentiaire du Goulag. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1970.
2. Nikolaï Epplé est un chercheur indépendant qui travaille sur la culture mémorielle internationale et sur la mémoire de la terreur d’État soviétique. Il est l’auteur du Passé inconfortable: Mémoire des crimes d’État en Russie et dans d’autres pays. Il est diplômé de l’Université d’État russe pour les sciences humaines (Moscou), où il a étudié la philologie classique et la philosophie.
3. Toutefois, ces études ont été critiquées pour des raisons méthodologiques.
4. « Euromaïdan » désigne les manifestations pro-européennes ukrainiennes qui se sont déroulées sur la place de l’Indépendance, place principale de Kiev en 2014 et qui ont débuté fin 2013 à la suite de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne au profit d’un accord avec la Russie (Wikipédia).
5. La loi russe sur les agents étrangers exige que quiconque reçoit un « soutien » de l’extérieur de la Russie ou soit sous « l’influence » de l’extérieur de la Russie s’enregistre et se déclare comme « agent étranger ». Une fois enregistrés, ils sont soumis à des audits supplémentaires et sont obligés de marquer toutes leurs publications avec une clause de non-responsabilité indiquant qu’elles sont distribuées par un « agent étranger ». L’expression « agent étranger » en russe a de fortes associations avec l’espionnage de l’époque de la guerre froide (Wikipédia).