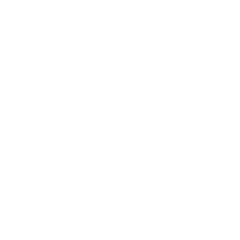L’État belge s’est construit en 1830 sur les fondements philosophiques du libéralisme proclamant les grands principes de liberté, d’égalité et de souveraineté populaire. Mais s’il inscrit dans sa constitution jugée, à l’époque, comme étant l’une des plus libérales d’Europe, les libertés de presse, de culte, d’enseignement et d’association, le pouvoir est en réalité très peu partagé. En accordant le droit de vote aux seuls censitaires, l’ordre politique qui s’instaure exclut la masse populaire et donne la souveraineté à une infime minorité de citoyens (seul 1,1% de la population est admis à voter). Comme le rappelait M. Nothomb, alors ministre de l’Intérieur, «les Belges étaient libres mais à condition de ne pas avoir la prétention d’user de leur liberté». Le pouvoir est donc concentré entre les mains de «l’élite des citoyens» qui détiennent aussi les rênes de l’économie. Une économie qui connaît d’ailleurs une forte croissance avec l’installation progressive de l’industrialisation qui fait de la Belgique la seconde puissance industrielle européenne derrière l’Angleterre.
Dans les principaux secteurs d’activités (charbonnages, métallurgie, textile, verrerie), les entreprises ne sont plus, pour la plupart, de petites unités avec quelques dizaines de travailleurs, ou des entreprises familiales avec, à leur tête, quelques entrepreneurs novateurs. Beaucoup d’entre elles comptent désormais des centaines d’ouvriers. Les sociétés anonymes, devenues dès 1850 «l’un des facteurs de transformation majeurs du capitalisme en Belgique» se sont multipliées, sous l’action des banques pressées de reprendre des affaires qui exigent des capitaux de plus en plus importants pour faire face aux besoins nouveaux en techniques. Le regroupement industriel se développe grâce au soutien du marché des capitaux et aux liaisons de plus en plus actives entre la banque et l’industrie et des groupes de plus en plus puissants détenant des exploitations à tous les niveaux de la production se constituent.
La Belgique est en plein essor économique et les grands secteurs d’activité se soutiennent et se dynamisent mutuellement: le développement du secteur sidérurgique et du secteur verrier entretient la demande de produits miniers; l’essor du chemin de fer donne un coup de fouet à l’industrie sidérurgique, et l’expansion du commerce international ouvre de nouveaux débouchés à l’industrie belge. Il est estimé que vers 1850, le revenu moyen par tête donne 332 francs par habitant et 684 francs par personne active, soit un revenu national pour l’ensemble de la population (4359000 habitants en 1848) de l’ordre de 1,5 milliard de francs1. Comme l’écrit Marx, la Belgique était devenue «le paradis du capitalisme».
Mais derrière la prospérité apparente, il y a la pauvreté qui touche une large partie des travailleurs qui constituent la classe ouvrière2. Or cette pauvreté n’est pas simplement due à l’inconséquence et au manque de prévoyance, comme le laissent supposer les partisans du libéralisme, mais bien aux structures de la société et à l’organisation du travail qui les privent du droit de vote et les enferment juridiquement.
«Sale pauvre!»
C’est au nom du libéralisme que l’État n’intervient pas dans les rapports sociaux afin de ne pas mettre en danger l’équilibre naturel du marché3. Estimant que chaque individu est responsable de lui-même, donc de son destin, beaucoup d’«idéologues» de l’industrialisation —médecins, économistes, sociologues, hommes politiques— pensent que le dénuement de la classe laborieuse est largement surfait, et la misère ouvrière un faux problème. N’entend-on pas certains d’entre eux affirmer que les masses prolétaires «ne savent que dépenser» et qu’elles n’auront bientôt «plus rien à désirer, ni rien à faire»... ou même que «ce sont les propriétaires et les capitalistes qui souffrent et que l’inégalité est en faveur de l’ouvrier et non du maître qui est sacrifié»! Pourtant de nombreuses enquêtes menées par les gouvernements sur la situation de la classe ouvrière dénoncent des conditions de vie et de travail particulièrement pénibles.
Une des rares mesures prises à l’époque concerne l’instauration, en 1850, de la Caisse générale de retraite et en 1851 la reconnaissance par l’État des premières sociétés de secours mutuelles aux règles de fonctionnement restrictives. En 1865, ce sera la fondation de la Caisse générale d’épargne et de retraite. Chargée d’encourager l’épargne dans les classes ouvrières, elle restera longtemps une utopie car, comme le faisait remarquer un député: «avant de s’occuper de l’épargne des travailleurs, il fallait savoir si le salaire des travailleurs n’était pas insuffisant, même pour leurs besoins journaliers. Dans les conditions où ils se trouvent actuellement, épargner et vivre sont, pour les travailleurs, deux choses qui s’excluent. Sur 1308364 ouvriers, seuls 5442 ont un salaire de plus de 3 francs par jour».
Si intervention il y a, elle ne peut prendre que la forme de la bienfaisance et de la philanthropie privées même si certains auteurs pensent que seule la moralisation pourra faire quelque chose: «sur 100 d’entre eux, il y en a 75 de vicieux et de corrompus, sans aucun sentiment d’élévation dans la pensée, ni de dignité dans le cœur. C’est parmi eux que se recrutent les parasites de la société, les flibustiers de l’aumône. C’est parmi eux que grouillent les internationalistes et les grévistes; en un mot, la lie qui se dépose au fond des prisons et des dépôts de mendicité»4.
Soutien à l’expansion
La non-intervention n’existe qu’en principe car, dans la réalité, à différentes reprises, l’État doit intervenir pour réguler le marché (notamment dans le cas de la protection de l’agriculture). L’exemple le plus frappant d’intervention directe de l’État dans l’activité économique est lié au développement du réseau de chemin de fer. Ainsi, en 1843, l’État terminait le programme de création d’un réseau de chemin de fer en étoile au départ de Malines qui avait été voté neuf ans plus tôt en 1834. Il cédera finalement ses prérogatives au secteur privé par l’octroi de concessions dès 1845 avant de se lancer dans une politique de rachat des lignes privées après 1870. Autre exemple: afin de pallier à la crise financière de 1848, l’État crée encore en 1850 la Banque Nationale qui lui permet de garantir la stabilité monétaire en cas de défaillance du secteur privé.
Ainsi, dès que les investissements sont trop élevés pour le secteur privé ou que le bénéfice se fait attendre, le principe du «laisser-faire» est mis de côté. Afin de soutenir l’expansion économique, l’État interviendra encore notamment par la mise en place de différentes mesures protectrices (protectionnisme douanier, soutien aux entreprises en difficulté…). Il faut toutefois noter que cet interventionnisme résulte moins d’une volonté gouvernementale que de la pression des lobbies industriels exercée sur lui. Il n’est en fait combattu que lorsqu’il y a intervention en faveur des travailleurs. Ainsi, sous prétexte d’un libéralisme économique qui, on l’a vu, supporte de nombreuses entorses lorsque les intérêts de la bourgeoisie les justifient, les gouvernements qui se succèdent refusent toute intervention dans le domaine social même sur des sujets aussi sensibles que la question du travail des enfants5. Les propositions de réglementation du travail des enfants sont régulièrement tenues en échec par les partisans du libéralisme économique ainsi que par certains industriels qui justifient la nécessité du travail industriel des enfants au nom de la saine gestion des entreprises devant faire face à la concurrence internationale et à la rentabilité des investissements. D’autres arguments d’ordre moral (et non plus de nature économique) sont également avancés afin de justifier cette exploitation. Un des arguments les plus sordides fait appel à la puissance paternelle qu’un projet de réglementation pourrait mettre en cause et porterait atteinte à la liberté des parents en intervenant dans l’éducation des enfants par le biais de la législation: «Une loi sur le travail des enfants, c’est une loi qui destitue en masse de la tutelle naturelle et légitime de leurs enfants les pères de famille des classes laborieuses; c’est une loi qui déclare qu’ils sont à la fois indignes et incapables d’exercer convenablement cette tutelle, c’est une loi qui proclame qu’au sein des classes laborieuses, les pères sont sans cœur et les mères sans entrailles», clame le parlementaire Frère Orban lors d’une séance de la Chambre des représentants.
L’interventionnisme inéluctable
Alors que l’économie avait connu deux décennies de prospérité, la récession atteint la Belgique dans les années 1885-1886. De nouveaux courants de pensée étaient apparus (le Parti ouvrier belge est créé en 1885) et certaines voix commençaient à s’élever aussi bien du côté libéral que du côté catholique afin de dénoncer «l’exploitation de l’homme par l’homme». Quant aux socialistes, ils réclament une intervention dans les assurances sociales, la protection du travailleur ou encore la nationalisation des biens de production. L’explosion sociale de mars 1886 qui secoue la Wallonie va ouvrir les yeux de la classe politique. Le parti catholique, qui est au pouvoir depuis 1884, s’était montré jusqu’alors farouchement hostile à toute ingérence de l’État dans ce qui relève de l’initiative privée. Les événements sanglants de 1886 vont l’amener à devoir prendre en urgence une série d’initiatives afin de pallier aux abus les plus criants, tout en n’oubliant cependant pas de renforcer le système répressif à l’égard des grévistes. Les premières lois sociales sont ainsi votées avec, en 1887, la loi sur le paiement des salaires et son insaisissabilité par le biais des amendes. En 1889, le travail des femmes et des enfants sera à son tour réglementé. Ce sera en 1896, la publication de la loi sur les règlements d’atelier, suivie en 1900 par la loi relative au contrat de travail. Une loi de 1889 concernait la prévention des accidents de travail6. Elle sera complétée en 1903 par la réparation des dommages résultant des accidents de travail introduisant la notion de risque professionnel et de la responsabilité industrielle. En 1903, le problème des maladies professionnelles est également posé.
Le paysage politique est également bouleversé avec l’émergence du mouvement socialiste et l’obtention en 1893 du suffrage universel tempéré par le vote plural qui permet à 23 députés socialistes d’entrer au Parlement. Du côté catholique aussi, les choses commencent à bouger avec la constitution d’un groupe de démocrates-chrétiens. Il est désormais plus que temps de faire des concessions en matière sociale.
Système d’assurances
Signe des temps, l’État se dote en 1895 d’un nouveau département, le ministère de l’Industrie et du Travail, et d’un service d’inspection chargé de veiller à l’application de la législation sociale. Les conseils de l’industrie et du travail et les conseils de prud’hommes sont également mis en place. L’opposition patronale à ces interventions est farouche: «le gouvernement voit tout, sait tout et entend tout. Il met des lois partout et inspecte partout (…). Le péril véritable réside dans l’intervention continue et pénétrante de l’État au sein même du domaine qui lui est le plus étranger par essence, le domaine de la liberté individuelle, de l’initiative privée, de l’industrie et du travail. Cette intervention qui multiplie les abus du fonctionnarisme, qui accroît immodérément les charges publiques, qui paralyse les volontés et tue l’esprit du progrès, est-ce autre chose qu’une préparation inconsciente à l’anarchie morale et politique, à l’écroulement universel des forces humaines dans une misère universelle?»7.
Malgré ces résistances, le processus de la mise en place d’un système d’assurances est également en marche. Il démarre avec le vote de la loi du 10mai 1900 sur les pensions de vieillesse qui organise l’assurance libre subsidiée (contributions de l’État et de l’assuré). Devant le peu de succès, l’État envisage d’instaurer l’assurance obligatoire pour tous, comme c’était déjà le cas pour certaines catégories professionnelles (les marins depuis 1845 et les mineurs en 1911).
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la priorité est donnée à la reconstruction du pays et de son économie mais également au maintien de la paix sociale. L’instauration du suffrage universel masculin en 1919 conforte le succès du parti socialiste qui entre dans un gouvernement d’union nationale. Les adhésions syndicales connaissent une croissance spectaculaire et l’article 310 du Code pénal qui punissait de lourdes peines quiconque portait atteinte à la liberté du travail est abrogé. L’instauration de la loi des huit heures en 1921 fait également partie des grandes conquêtes du mouvement ouvrier.
Dans les années 1920, l’État développe une véritable politique dans le champ des assurances sociales avec la création en 1920 du Fonds national de crise8 accordant une aide aux chômeurs. Mais la pression exercée par le patronat, qui ne participe en rien au financement de ce fonds, engendrera en 1921 la révision du système et l’instauration de la notion d’état de besoin. En matière de pensions, l’assurance obligatoire est étendue en 1924 à l’ensemble des ouvriers et en 1925 à l’ensemble des employés. L’existence de maladies professionnelles est reconnue en 1927.
Crise et Keynes
La crise économique mondiale qui atteint la Belgique en 1930 va cependant ralentir la construction du système de protection sociale. Les travailleurs sont frappés de plein fouet par la récession économique plongeant dans la misère les allocataires sociaux et tous ceux n’ayant aucun droit, étant donné le caractère libre de certaines assurances. Ces événements vont bouleverser la manière de concevoir les rapports entre l’État et l’économie. Le New Deal, lancé aux États-Unis par Franklin Roosevelt, est inspiré des théories du Britannique John Maynard Keynes. Ce dernier ne croit pas aux mécanismes autorégulateurs chers aux économistes libéraux. L’État doit au contraire intervenir de manière énergique pour soutenir et réguler l’activité économique.
En Belgique, le gouvernement libéral-catholique tente d’enrayer le déficit des finances publiques et de maintenir la stabilité du système monétaire en instaurant une politique de déflation: compression des dépenses, baisse des salaires et des pensions, réduction ou suppression des allocations… Cette politique fait peser le poids de la crise sur les travailleurs durement touchés par le chômage9 et accentue le marasme de la consommation intérieure.
L’échec de la politique déflationniste et le durcissement de la crise amènent un nouveau gouvernement aux commandes de l’État. Sous la férule de l’économiste Paul Van Zeeland, un gouvernement tripartite se lance dans un programme d’économie dirigée inspiré de l’expérience du New Deal10. Après avoir appliqué une forte dévaluation du franc belge permettant la relance des exportations, le gouvernement soutient une politique de travaux publics (entretien des routes, etc.) destinés à résorber le chômage et à relancer la consommation. Il se dote également d’instruments lui permettant de superviser l’activité du secteur bancaire et crée plusieurs organismes parastataux de crédit. Le système d’assurance-chômage continue de se rationaliser avec la mise en place de l’Office national du placement et du chômage. La concertation sociale continue de se développer, les commissions paritaires s’institutionnalisent et la première rencontre interprofessionnelle prend forme lors de la Conférence nationale du travail réunie à la suite des grèves de 1936. De nouveaux acquis sont obtenus, comme la première semaine de congés payés, la loi-cadre sur la semaine de 40 heures, etc.
En 1939, certains secteurs qui constitueront la sécurité sociale (pensions, accidents de travail, maladies professionnelles) fonctionnent déjà sur le principe de l’assurance obligatoire. Seuls les secteurs maladie-invalidité et chômage fonctionnent encore sur le principe de l’assurance libre subsidiée.
Pacte social
Le débat sur les assurances sociales obligatoires sera une fois encore interrompu lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale. C’est toutefois durant cette période que l’idée d’instaurer un ensemble coordonné recouvrant l’ensemble des assurances obligatoires est en pourparlers et trouve sa concrétisation en avril 1944. Les partenaires sociaux réunis clandestinement signent le projet d’accord de solidarité sociale qui donne naissance à la sécurité sociale financée par les travailleurs, le patronat et l’État et gérée par les partenaires sociaux.
Le pacte social atteste de l’évolution du rapport entre les forces sociales devenues des partenaires sociaux. Patronat et syndicats (capital et travail) acceptent de collaborer dans le cadre d’une économie de marché, sous l’arbitrage d’un État impliqué. «Dans cet esprit, les représentants des deux parties se sont mis d’accord pour demander au gouvernement de prendre, dès le retour du pays à l’indépendance, une série de mesures d’urgence propres à réparer les misères subies pendant l’occupation par la grande masse des travailleurs salariés, propres aussi à ouvrir la voie à un courant renouvelé de progrès social, découlant à la fois de l’essor économique d’un monde pacifié et d’une équitable répartition du revenu d’une production croissante» (Projet d’accord de solidarité sociale, août 1944).
Durant les «Trente Glorieuses», tandis que se construit et se complexifie l’édifice de la Sécurité sociale (loi sur la gestion paritaire des organismes publics de la Sécurité sociale, 1963), la pratique de la concertation s’institutionnalise à tous les niveaux par le biais d’une multitude d’organismes paritaires, consultatifs et autonomes. Les commissions paritaires obtiennent un statut légal par l’arrêté loi du 9 juin 1945. Le principe de la délégation syndicale est reconnu. En 1948, la loi sur l’organisation de l’économie jette les bases des Conseils d’entreprises. Le Conseil national du Travail est créé en 1952, les conférences nationales du Travail sont relancées. Les premières élections sociales se déroulent en 1950 et le premier accord interprofessionnel est conclu en 1960. En 1954, afin d’accroître la productivité, syndicats et patrons négocient une Déclaration commune sur la productivité.
À partir de la fin des années 1950, l’État finance une série d’infrastructures nécessaires à l’expansion économique. Ce sera le développement autoroutier, développement du port et, plus tard, l’installation de raffineries de pétrole à Anvers, le projet de construction d’un terminal gazier à Zeebrugge… C’est aussi les débuts des investissements dans le nucléaire. Des lois d’expansion économique sont promulguées en 1959, puis 1966 et en 1970. Le Bureau du Plan est institué. Avec la Société nationale d’investissements, l’État entreprend de mener sa propre politique d’investissement (1962) et accorde un important soutien aux secteurs industriels en difficulté (charbonnages, textile et sidérurgie).
L’État providence s’épanouit pleinement durant les golden sixties grâce au développement d’une économie de consommation de masse, axée sur le plein-emploi, la hausse continue du pouvoir d’achat et des transferts sociaux toujours plus importants autorisés par la croissance des recettes publiques.
Crise mondiale
Le choc pétrolier de 1973 éclate dans un contexte de haute conjoncture avec un taux de croissance annuel du PIB mondial supérieur à 4,5% depuis 1970 et un taux de chômage faible. Ce premier choc pétrolier a plusieurs effets majeurs: une accélération de l’inflation par répercussion de la hausse des coûts dans les prix de vente, une forte récession sous le double effet du poids de la facture pétrolière et des politiques d’austérité ordonnées afin de juguler l’inflation, une augmentation de l’épargne mondiale ainsi qu’un déséquilibre des balances des paiements courants.
À la fin des années 1970, la dette publique des États qui appliquent des politiques keynésiennes pour conjurer une crise que l’on croit momentanée s’emballe. Les dépenses croissent et les recettes fiscales directes et indirectes se réduisent. À partir des années 1980, alors que vient de se produire un nouveau choc pétrolier11, il devient manifeste que la crise est profonde et durable. Elle révèle les profonds changements qui se sont opérés discrètement à l’intérieur du système économique mondial. L’internationalisation des entreprises et la libéralisation financière révèlent l’impuissance de l’État national à remplir son rôle de régulateur économique. L’esprit même du capitalisme a changé: la priorité est accordée à la rentabilité du capital et non plus à la croissance des entreprises qui caractérisait les golden sixties et sur laquelle était basé le compromis social-démocrate. Dans ce contexte, le rapport de force entre le patronat et les travailleurs bascule progressivement en défaveur de ces derniers. En Belgique, la concertation sociale se grippe.
Dans ce contexte, le bien-fondé du rôle régulateur de l’État dans le champ socio-économique est remis en cause par une école de pensée néo-libérale. L’État social est pointé du doigt pour son coût jugé exorbitant et ses rigidités de fonctionnement qui ne répondent plus aux nouvelles «insécurités». Il est accusé d’interférer dans les fameux mécanismes autorégulateurs du marché, lesquels seraient seuls capables d’enrayer la crise économique. Pour les détracteurs de l’État-providence, celui-ci n’a pu, par ses interventions, enrayer ni la montée du chômage ni celle de l’inflation. De plus, «la plupart des protections sociales sont l’héritage d’une époque révolue, lorsque des compromis sociaux étaient compatibles avec les impératifs du marché»12.
En Belgique, cette évolution se marque par l’adoption, durant les années 1980, de plans d’austérité destinés à bloquer les salaires afin de modérer les coûts salariaux, conjurer l’inflation et relancer la compétitivité des entreprises. Dans le même temps et selon la même optique, la législation encourage la flexibilité du travail, le temps partiel, les contrats à durée déterminée, etc. Parallèlement diverses mesures sont prises afin de conditionner l’obtention des allocations de chômage (limitation des montants pour les cohabitant-e-s, exclusion des chômeurs de longue durée...). D’une manière générale, c’est tout le système de protection mis en place après la guerre qui est accusé de mobiliser trop de ressources et de favoriser la passivité de certains bénéficiaires. On assiste à un désengagement de l’État et de l’assurance, on semble basculer vers un retour à l’assistance. Le droit social, accusé de perturber le système économique, est remis en cause. Pourtant l’État intervient encore lorsqu’il s’agit d’aider les entreprises au niveau de l’emploi en réduisant les charges patronales, en finançant des emplois (TCT…).
Retour du libéralisme
On assiste au retour en force de la pensée néo-libérale et du principe de la concurrence et de la «compétitivité». Cette obsession touche également le secteur public. L’application des directives européennes mettant un terme à des monopoles de services publics quasi centenaires, amène l’État à moderniser ses entreprises en les réformant et en déléguant au secteur privé, en tout ou en partie les services aux usagers (les télécommunications, la poste, le transport ferroviaire, l’aviation, etc.). Les instruments d’intervention étatique, sur le plan économique, se réduisent considérablement tandis que, sur le plan social, les nécessités d’intégration dans l’espace européen restreignent les marges de manœuvre.
À la fin du XXe siècle, l’État, violemment critiqué puis, en fin de compte, réhabilité, est à la recherche de nouveaux modes d’intervention, adaptés à un contexte économique bouleversé tout en respectant son héritage social-démocrate. Cette recherche du compromis a donné naissance au concept de la «troisième voie» en Angleterre, concept qui s’est concrétisé dans la notion d’«État social actif» en Belgique.
Au total, pendant les trois dernières décennies, on a assisté à une résurgence du libéralisme économique qui, à l’occasion notamment de la mondialisation des échanges, commerciaux et autres, s’est diffusé sur la planète entière et a contribué à refaçonner les sociétés en remodelant complètement leurs structures fondamentales (sociales, de l’emploi, etc.), en modifiant les valeurs collectives (individualisme, sécurité, etc.) et en redéfinissant le rôle des grands agents institutionnels (État, syndicats, patronat…).
Le capitalisme, qui a connu une de ses nombreuses transformations depuis ses cinq siècles d’existence en passant de sa forme industrielle à sa forme financière, a pu donner l’impression qu’il était arrivé à un état d’aboutissement ultime, la «fin de l’histoire» en quelque sorte. Mais celle-ci vient de se rappeler à nous en provoquant une des plus grandes crises économiques de tous les temps, que la remontée en puissance de l’interventionnisme étatique n’a pas véritablement réussi à juguler en venant à l’appui des banques menacées de faillite. Tout au plus, les États en apportant leur caution à un système financier défaillant, ont-ils pu limiter la catastrophe et empêcher l’émergence d’un chaos généralisé, mais rien n’est définitivement garanti pour les prochaines décennies. La question est dorénavant posée de savoir si l’extraordinaire réussite de l’accumulation des richesses et du gonflement des profits (principalement du capital) n’était pas un énorme leurre appelé à guider nos sociétés vers une impasse de l’évolution (à la manière dont Darwin les avait imaginées). Comme le rappelait déjà l’historien et sociologue Immanuel Wallerstein, on se demande si le système tel qu’il a été imaginé à la fin du siècle dernier par les doctrinaires du néo-libéralisme et les défenseurs inconditionnels de la supériorité absolue des lois du marché face à toutes les tentatives de régulation étatique (à un point qu’Adam Smith, le père de la fameuse «main invisible» n’aurait probablement pas cautionné) n’a pas atteint aujourd’hui ses limites et s’il ne risque pas de «mourir de sa réussite». Rien n’est moins sûr, vu l’extraordinaire capacité du capitalisme à tirer les leçons de ses échecs et à intégrer les nouvelles tendances idéologiques. Mais il est clair qu’il devra dorénavant compter avec la puissance croissante du courant écologiste qui est là pour lui rappeler qu’une croissance infinie dans un monde fini est impossible, et que l’exploitation immodérée des ressources de la Terre constitue une menace pour l’ensemble de l’humanité.
(*) Carhop. Pour en savoir plus: Questions d’histoire sociale, Bruxelles, Carhop-Fec, 2005.
1 Lebrun, P., Bruwier, M., Dhondt, J. et Hansotte, G., Essai sur la révolution industrielle en Belgique. 1770-1847, Bruxelles, Palais des Académies, 1981, tome II, vol 1 (collection Histoire quantitative et développement de la Belgique).
2 À lire: Neuville, J., La condition ouvrière au XIXesiècle, 2 t., Bruxelles, EVO, 1977.
3 Neuville, J., L’évolution des relations industrielles en Belgique, Bruxelles, EVO, 1975.
4 De Laroière, Ch.-F., Guerre au paupérisme par la moralisation, Bruges, 1879, p. 5, (cité par Neuville, J., La condition ouvrière au XIXe siècle, t. 2: L’ouvrier suspect, Bruxelles, EVO, 1977, p. 109.).
5 Loriaux, Fl., Enfants-machines. Histoire du travail des enfants en Belgique aux XIXe et XXe siècles, Bruxelles, Carhop-EVO, 1999.
6 Lire sur le sujet: Les cadences infernales. Histoire de la pénibilité du travail, Bruxelles, Carhop-FEC, 2003.
7 Bulletin du Comité central du travail industriel, octobre 1895, p.147.
8 Histoire d’un acquis: l’allocation de chômage, Bruxelles, Carhop, 1988.
9 La politique de restriction se portera sur des groupes spécifiques que sont les chômeurs, les femmes et les travailleurs étrangers. Cf. Coenen, M.-Th., Syndicalisme au féminin, Bruxelles, Carhop, 2008. Coenen, M.-Th., Les syndicats et les immigrés. Du rejet à l’intégration, Bruxelles, Carhop-Fec-EVO, 1999.
10 D’autres réponses à la lutte contre la crise sont apportées dans un programme développé par les socialistes. Ce sera le Plan du Travail qui vise l’organisation rationnelle de l’économie en prônant la nationalisation de divers secteurs économiques, des investissements dans les travaux publics pour contrer le chômage, une réforme des structures politiques…
11 La reprise économique de 1976 à 1979 ne parvient cependant pas à résorber le chômage et l’inflation. Le second choc pétrolier de 1979-1980 provoque un nouveau tassement de l’activité: faible croissance du PIB, accélération de l’inflation, détérioration des échanges extérieurs. Ces deux chocs pétroliers vont installer dans les pays industrialisés une situation de stagflation (combinaison de récession, de chômage, d’inflation et de déséquilibre extérieur) qui n’est pas sans conséquence pour le reste du monde.
12 Castel, R., Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995, p. 436.