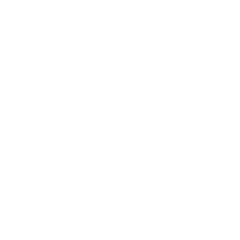La naissance du droit social est traditionnellement considérée comme le premier pas juridique vers l’émancipation des travailleurs. Il a en effet permis à ceux-ci de bénéficier de droits plus étendus que ceux garantis par le seul Code civil. Dans un article en deux temps, Paul Palsterman s’interroge sur la pertinence de cette vision pour le passé, et sur son sens pour la défense des droits des travailleurs d’aujourd’hui.
Une Vulgate très répandue, jusque dans les introductions des syllabus de droit social de nos universités, veut que le Prolétaire avait gémi, pendant tout le XIXe siècle, sous le joug du Code Civil, instrument de pouvoir du régime de Bourgeoisie Absolue qui régnait à l’époque sur l’Europe occidentale, avant de s’en affranchir par l’émergence d’un Droit Social qui, reconnaissant l’inégalité fondamentale de condition entre l’Employeur, maître des moyens de production, et le Prolétaire, condamné pour survivre à vendre sa Force de Travail, aurait enfin pris la juste mesure de la célèbre phrase de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère ».
Cette conception n’est pas fausse, mais elle mériterait d’être nuancée. L’histoire intellectuelle du droit social est moins linéaire, plus complexe, et pour tout dire plus intéressante, que ce qu’en dit la Vulgate. En prendre la mesure n’est pas sans intérêt, à une époque où des questions existentielles sont posées sur l’avenir du droit du travail.
Première remarque, le Code civil était (et est) peu loquace sur le contrat de travail. Dans le Code civil, le contrat de travail, appelé contrat de « louage des gens de travail » (ou « louage de travail »), se distingue peu des autres « louages d’ouvrage et d’industrie », à savoir le contrat (habituellement dénommé « louage de services ») qui lie un entrepreneur indépendant à un maître d’ouvrage, et celui du « voiturier par terre et par eau ». Avec les baux et autres locations de choses, ces contrats constituent l’ordre des contrats de louage, lesquels font partie de la grande famille des « obligations conventionnelles ». Et celles-ci sont classées, avec les héritages, les dons et legs, les régimes matrimoniaux (c’est-à-dire les conséquences économiques du mariage) et quelques autres « engagements qui se forment sans convention », parmi « les différentes manières dont on acquiert la propriété ». Bref, le contrat de travail appartient, fondamentalement, à la sphère économique.
Ce qui peut paraître aujourd’hui comme un truisme ne l’était nullement à l’époque, et en réalité ne l’est pas tellement aujourd’hui non plus. Par le contrat de travail, le travailleur s’engage à travailler sous l’autorité de l’employeur. C’est donc l’employeur, et non le travailleur ou le contrat, qui détermine au jour le jour le contenu des obligations du travailleur. Ce n’est pas impunément qu’on aliène ainsi sa liberté de décider à quoi occuper la moitié de son temps de veille (ou davantage, si l’on considère le temps de travail des ouvriers de l’époque ou des cadres surmenés d’aujourd’hui). « Vendre sa force de travail », que la Vulgate a repris de la phraséologie marxiste, ne reflète que très imparfaitement la réalité du travail salarié. Même le travail manuel le moins qualifié ne s’apparente pas à celui d’un bulldozer ou autres machines dont la « force de travail » peut être quantifiée en joules ou en litres d’huile (de bras). En acceptant la discipline de l’usine, du chantier ou du bureau, le travailleur « paie de sa personne » ; il engage réellement sa personnalité, ou du moins des pans importants de celle-ci.
Et plus le travail implique des relations interpersonnelles (la direction d’une équipe, le contact avec la clientèle ou avec des fournisseurs...), plus cette dimension personnelle du contrat de travail devient centrale. Accepter la discipline va bien au-delà d’obéir passivement aux ordres. Cela signifie savoir prendre sa place au sein d’une hiérarchie, y compris, pour les supérieurs, savoir concevoir, donner et suivre l’exécution des ordres, et, pour le subordonné, informer et conseiller son supérieur, voire discuter (à bon escient !) certains de ses ordres. Cela signifie participer à une culture d’entreprise.
Une fois sa journée finie, le travailleur n’est pas une machine qu’on met au garage. La vie de travailleur exerce une profonde influence sur sa vie privée, et vice-versa. Ce n’est pas par hasard que les engagements sociaux, les hobbies, les sports et la situation familiale font classiquement partie du CV des demandeurs d’emploi, au même titre que les diplômes et l’expérience professionnelle. Quiconque a l’expérience des recrutements peut attester que ces éléments personnels ont beaucoup de poids dans la décision d’embaucher, tout comme, plus tard, dans l’évolution de la carrière du travailleur. Les « déformations professionnelles » qui rejaillissent sur le comportement personnel de certains travailleurs relèvent plutôt de l’anecdote amusante. Il y a aussi des questions plus fondamentales. Tracer la limite entre la vie privée et le travail est souvent problématique. La limite chronologique est parfois floue, surtout dans le contexte actuel de flexibilité et de développement de moyens techniques (GSM, ordinateurs connectés à l’internet...) permettant d’effectuer des prestations en dehors des locaux de l’entreprise. Riche d’enseignements est la jurisprudence des tribunaux du travail sur le point de savoir si un fait de la vie privée peut justifier un licenciement pour motif grave. Le motif grave est légalement défini comme « la faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles ». Il n’est dit nulle part que cette faute grave doit être une faute dans l’exécution du travail ; dans la pratique, la majorité des motifs graves ont l’exécution du contrat de travail comme contexte, mais ne concernent pas l’exécution du travail proprement dit. Ils ont, bien plus souvent, à voir avec la loyauté à l’égard de l’employeur, avec les relations avec la hiérarchie, les collègues, les clients, etc. La jurisprudence établit une certaine frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, mais cette frontière est floue : certains faits de la vie privée, même commis en dehors de la sphère du travail, peuvent interférer avec le professionnel au point de justifier un licenciement pour motif grave. Et en tout cas, ils peuvent généralement justifier un licenciement avec préavis. En dehors de sa classification dans la taxonomie juridique, que disait le Code civil du contrat de travail ?
Il dérogeait aux règles habituelles de preuve, en admettant qu’un contrat de travail se prouve autrement que par un écrit signé par les parties. De telles dérogations existent également pour d’autres contrats intéressant des prolétaires illettrés, notamment les baux. Le contrat de travail peut donc se prouver par témoins ou par présomptions. C’est toujours le cas aujourd’hui.
Mais l’article 1781 du Code civil, abrogé en 1883, contenait une disposition plus perfide, dérogatoire au droit commun de la preuve, et que la Cour d’arbitrage, si elle avait existé à l’époque, aurait sans aucun doute déclarée discriminatoire : c’est qu’à défaut d’autre élément de preuve, l’employeur sera cru sur sa parole, contre celle de l’ouvrier.
Pour le reste, le Code civil contient une seule disposition relative au contrat de travail : l’article 1780, toujours en vigueur, qui prévoit qu’« on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée ». Telle que formulée, cette disposition semble protéger le travailleur : on peut aliéner sa liberté en s’engageant à obéir à un patron, mais cet engagement est révocable, par opposition à d’autres sujétions qui ont existé en d’autres temps et existent toujours en d’autres lieux. Mais en réalité, il a toujours été admis que la règle fonctionnait à double sens : l’employeur non plus ne peut pas s’engager à occuper un travailleur à vie. Il est possible de renforcer par convention (individuelle ou collective) la protection légale du licenciement (« clauses de stabilité d’emploi »), mais pas au point d’empêcher l’employeur de licencier, ni même de rendre le licenciement tellement onéreux que l’employeur serait contraint d’y renoncer. Il est vrai que cette interprétation ne se prévaut pas uniquement d’une exégèse du Code. On invoque aussi rien moins que les Droits de l’Homme (ah ! les Droits de l’Homme !), en l’occurrence la liberté du travail. Mais il est piquant (et symptomatique) de constater que, dans le sens qui semblait dicté par le Code civil (le droit du travailleur de quitter unilatéralement l’employeur), le droit en vigueur a longtemps été plus restrictif.
Car on commettrait une erreur fondamentale de perspective (pourtant souvent commise par la Vulgate) en croyant qu’en dehors du Code civil, le droit belge était muet sur la question du contrat de travail, même avant les premières lois sur la protection contre le blanc de céruse ou le travail des enfants de moins de 12 ans au fond de la mine. Si le Code civil s’intéressait moins au contrat de travail qu’aux héritages, à la vente ou aux baux, ce n’est pas parce que le législateur s’en désintéressait, ni même, comme on l’a dit, parce que la France de Napoléon n’avait pas encore été touchée par la Révolution industrielle. C’est, tout simplement, qu’on considérait que la législation spécifique du travail était satisfaisante, et n’avait pas besoin d’être reprise dans le Code civil. Ce choix fut moins unanime et indiscuté qu’on ne le dit généralement. Ce qu’on peut appeler l’aile gauche du parlement avait plaidé pour faire de l’ouvrier un réel partenaire contractuel de l’employeur. Et si le choix contraire a été fait, c’est parce qu’on a considéré que l’ouvrier n’avait ni l’éducation ni le discernement qui lui permettraient d’assumer réellement un rôle économique autonome. On l’a dès lors assujetti à un droit spécifique qui assurait le pouvoir de l’employeur, et qui, bien davantage que la liberté, caractérisait réellement la « condition de prolétaire ». Les éléments de cette réglementation, qui non seulement ne faisait pas partie du Code civil, mais dérogeait même à sa logique profonde, méritent d’être rappelés.
Il y avait d’abord le livret ouvrier. Le livret ouvrier était une sorte de permis de travail pour autochtones. Comme le permis de travail, c’était un document indispensable pour pouvoir travailler comme ouvrier. À la différence du permis de travail moderne, le livret ouvrier n’était cependant pas une sorte de document d’identité. Il s’apparente plutôt au livret militaire, dont il était d’ailleurs inspiré. Pendant la relation de travail, il était détenu par l’employeur. Celui-ci avait le pouvoir de le retenir si le travailleur quittait l’entreprise sur un désaccord. En somme, comme le livret militaire, le livret ouvrier voulait dépister les déserteurs et les insoumis. Le but premier de l’institution était d’empêcher les ouvriers d’« abuser » de la liberté contractuelle offerte par le Code civil, y compris l’article 1780 déjà cité, pour quitter leur employeur au profit d’une embauche mieux payée.
Au nom de la liberté contractuelle, la fameuse loi Le Chapelier interdisait les « coalitions ouvrières », c’est-à-dire les ententes, structurées ou non, permanentes ou non, en vue de peser collectivement sur les salaires. De telles coalitions ne viciaient pas seulement le contrat conclu sous leur « contrainte » : elles étaient punies par le Code pénal. Les « coalitions d’employeurs », par contre, autrement dit les ententes diverses, formelles ou informelles, entre employeurs, n’étaient pas aussi systématiquement interdites. Il est notoire que des « ententes sur les prix » étaient conclues entre employeurs au sein des associations sectorielles et des chambres de commerce et d’industrie.
La loi Le Chapelier n’avait pas été votée par le Parlement belge. Comme le Code civil et la plupart des lois en vigueur en Belgique au moment de son indépendance, c’était un vestige de la période où les provinces belges étaient des départements français. Il y aurait eu un excellent motif de la considérer comme caduque en Belgique : la Constitution belge de 1831, qui garantissait la liberté d’association, sans établir d’exception en ce qui concerne les associations destinées à la défense collective des droits des travailleurs. Ce n’est qu’en 1921 que la législation belge a enfin concrétisé ce principe constitutionnel, par une loi garantissant la liberté d’association, y compris au niveau des syndicats. La création de syndicats est libre ; tout le monde est libre de s’affilier à un syndicat, dans les seules limites des statuts de celui-ci ; nul ne peut être obligé de le faire.
Des éléments importants de la relation de travail n’étaient pas fixés par le contrat. On se rappellera que celui-ci était, à l’époque plus encore qu’aujourd’hui, verbal, et cette technique contractuelle se prête mal à des clauses sophistiquées. Le mesurage du travail, les horaires de travail, les motifs graves de rupture du contrat et autres sanctions disciplinaires, la durée des préavis, étaient fixés par le « règlement d’atelier », ancêtre des règlements de travail d’aujourd’hui. Le règlement d’atelier était établi et modifié unilatéralement par l’employeur. Celui-ci avait donc non seulement la capacité économique, mais aussi le pouvoir juridique, de modifier unilatéralement des éléments essentiels de la relation de travail. Il s’agit d’une dérogation aux mécanismes ordinaires du Code civil.
Un bailleur peut agiter la menace économique de ne pas renouveler le bail pour imposer au locataire une hausse de loyers. L’ouvrier ne pouvait même pas rompre le contrat aux torts de l’employeur s’il était en désaccord avec la modification du règlement d’atelier. Cette caractéristique a été conservée par les règlements de travail d’aujourd’hui, qui ont par ailleurs conservé plusieurs compétences des anciens règlements d’atelier. Mais il faut dire que le contexte a considérablement changé. D’une part, le règlement de travail n’est plus établi unilatéralement par l’employeur. La procédure prévoit un droit d’expression des travailleurs, un contrôle de l’inspection du travail, et un rôle d’arbitrage à la commission paritaire. D’autre part, la pratique des contrats écrits est beaucoup plus répandue qu’à l’époque, et il est permis de déroger au règlement de travail par une clause contractuelle soumise, conformément au Code civil, au principe de l’immutabilité des conventions. Et surtout, les principales prérogatives du règlement de travail (notamment l’horaire de travail et les préavis) sont étroitement encadrées par un droit impératif, protecteur du travailleur, établi par la loi et la réglementation, ou par des conventions collectives.
Et enfin, pour surveiller tout cela, fonctionnaient des juridictions d’exception : les conseils de prud’hommes. Il est classique de voir dans les conseils de prud’hommes les ancêtres des actuels tribunaux du travail, et c’était en effet le cas des juridictions qui fonctionnaient sous ce nom à la veille de la réforme judiciaire, en 1971. Mais les conseils de prud’hommes du 19e siècle présentaient des caractéristiques très différentes de leurs homonymes du 20e et des actuels tribunaux du travail. Ces derniers sont présidés par un magistrat de carrière, nommé selon les critères habituels de nomination dans la magistrature. Il comprend également un nombre égal d’assesseurs, présentés respectivement par le patronat et par les syndicats. Il est compétent pour l’ensemble du contentieux civil dans les matières sociales. Les « prud’hommes » étaient à l’origine des juges non professionnels, nommés sur présentation du patronat, du personnel de maîtrise et des « ouvriers patentés », c’est-à-dire indépendants. Ils étaient assistés d’un « assesseur juridique », dont le rôle était de transcrire la sentence en termes juridiques. Les ouvriers salariés tombaient sous leur juridiction, mais n’étaient pas représentés dans le siège. Les conseils de prud’hommes avaient des compétences plus limitées que les tribunaux du travail actuels mais, contrairement à ces deniers, ils avaient aussi une compétence pénale, dans le domaine des secrets de fabrication. Leur rôle premier et avoué était d’empêcher les ouvriers d’« abuser » de la liberté contractuelle en vendant au plus offrant le know-how acquis dans leurs divers emplois.
Paul Palsterman
Une Vulgate très répandue, jusque dans les introductions des syllabus de droit social de nos universités, veut que le Prolétaire avait gémi, pendant tout le XIXe siècle, sous le joug du Code Civil, instrument de pouvoir du régime de Bourgeoisie Absolue qui régnait à l’époque sur l’Europe occidentale, avant de s’en affranchir par l’émergence d’un Droit Social qui, reconnaissant l’inégalité fondamentale de condition entre l’Employeur, maître des moyens de production, et le Prolétaire, condamné pour survivre à vendre sa Force de Travail, aurait enfin pris la juste mesure de la célèbre phrase de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui libère ».
Cette conception n’est pas fausse, mais elle mériterait d’être nuancée. L’histoire intellectuelle du droit social est moins linéaire, plus complexe, et pour tout dire plus intéressante, que ce qu’en dit la Vulgate. En prendre la mesure n’est pas sans intérêt, à une époque où des questions existentielles sont posées sur l’avenir du droit du travail.
La force de travail : un objet à vendre ?
Première remarque, le Code civil était (et est) peu loquace sur le contrat de travail. Dans le Code civil, le contrat de travail, appelé contrat de « louage des gens de travail » (ou « louage de travail »), se distingue peu des autres « louages d’ouvrage et d’industrie », à savoir le contrat (habituellement dénommé « louage de services ») qui lie un entrepreneur indépendant à un maître d’ouvrage, et celui du « voiturier par terre et par eau ». Avec les baux et autres locations de choses, ces contrats constituent l’ordre des contrats de louage, lesquels font partie de la grande famille des « obligations conventionnelles ». Et celles-ci sont classées, avec les héritages, les dons et legs, les régimes matrimoniaux (c’est-à-dire les conséquences économiques du mariage) et quelques autres « engagements qui se forment sans convention », parmi « les différentes manières dont on acquiert la propriété ». Bref, le contrat de travail appartient, fondamentalement, à la sphère économique.
Ce qui peut paraître aujourd’hui comme un truisme ne l’était nullement à l’époque, et en réalité ne l’est pas tellement aujourd’hui non plus. Par le contrat de travail, le travailleur s’engage à travailler sous l’autorité de l’employeur. C’est donc l’employeur, et non le travailleur ou le contrat, qui détermine au jour le jour le contenu des obligations du travailleur. Ce n’est pas impunément qu’on aliène ainsi sa liberté de décider à quoi occuper la moitié de son temps de veille (ou davantage, si l’on considère le temps de travail des ouvriers de l’époque ou des cadres surmenés d’aujourd’hui). « Vendre sa force de travail », que la Vulgate a repris de la phraséologie marxiste, ne reflète que très imparfaitement la réalité du travail salarié. Même le travail manuel le moins qualifié ne s’apparente pas à celui d’un bulldozer ou autres machines dont la « force de travail » peut être quantifiée en joules ou en litres d’huile (de bras). En acceptant la discipline de l’usine, du chantier ou du bureau, le travailleur « paie de sa personne » ; il engage réellement sa personnalité, ou du moins des pans importants de celle-ci.
Et plus le travail implique des relations interpersonnelles (la direction d’une équipe, le contact avec la clientèle ou avec des fournisseurs...), plus cette dimension personnelle du contrat de travail devient centrale. Accepter la discipline va bien au-delà d’obéir passivement aux ordres. Cela signifie savoir prendre sa place au sein d’une hiérarchie, y compris, pour les supérieurs, savoir concevoir, donner et suivre l’exécution des ordres, et, pour le subordonné, informer et conseiller son supérieur, voire discuter (à bon escient !) certains de ses ordres. Cela signifie participer à une culture d’entreprise.
Une fois sa journée finie, le travailleur n’est pas une machine qu’on met au garage. La vie de travailleur exerce une profonde influence sur sa vie privée, et vice-versa. Ce n’est pas par hasard que les engagements sociaux, les hobbies, les sports et la situation familiale font classiquement partie du CV des demandeurs d’emploi, au même titre que les diplômes et l’expérience professionnelle. Quiconque a l’expérience des recrutements peut attester que ces éléments personnels ont beaucoup de poids dans la décision d’embaucher, tout comme, plus tard, dans l’évolution de la carrière du travailleur. Les « déformations professionnelles » qui rejaillissent sur le comportement personnel de certains travailleurs relèvent plutôt de l’anecdote amusante. Il y a aussi des questions plus fondamentales. Tracer la limite entre la vie privée et le travail est souvent problématique. La limite chronologique est parfois floue, surtout dans le contexte actuel de flexibilité et de développement de moyens techniques (GSM, ordinateurs connectés à l’internet...) permettant d’effectuer des prestations en dehors des locaux de l’entreprise. Riche d’enseignements est la jurisprudence des tribunaux du travail sur le point de savoir si un fait de la vie privée peut justifier un licenciement pour motif grave. Le motif grave est légalement défini comme « la faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles ». Il n’est dit nulle part que cette faute grave doit être une faute dans l’exécution du travail ; dans la pratique, la majorité des motifs graves ont l’exécution du contrat de travail comme contexte, mais ne concernent pas l’exécution du travail proprement dit. Ils ont, bien plus souvent, à voir avec la loyauté à l’égard de l’employeur, avec les relations avec la hiérarchie, les collègues, les clients, etc. La jurisprudence établit une certaine frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, mais cette frontière est floue : certains faits de la vie privée, même commis en dehors de la sphère du travail, peuvent interférer avec le professionnel au point de justifier un licenciement pour motif grave. Et en tout cas, ils peuvent généralement justifier un licenciement avec préavis. En dehors de sa classification dans la taxonomie juridique, que disait le Code civil du contrat de travail ?
Preuve du contrat
Il dérogeait aux règles habituelles de preuve, en admettant qu’un contrat de travail se prouve autrement que par un écrit signé par les parties. De telles dérogations existent également pour d’autres contrats intéressant des prolétaires illettrés, notamment les baux. Le contrat de travail peut donc se prouver par témoins ou par présomptions. C’est toujours le cas aujourd’hui.
Mais l’article 1781 du Code civil, abrogé en 1883, contenait une disposition plus perfide, dérogatoire au droit commun de la preuve, et que la Cour d’arbitrage, si elle avait existé à l’époque, aurait sans aucun doute déclarée discriminatoire : c’est qu’à défaut d’autre élément de preuve, l’employeur sera cru sur sa parole, contre celle de l’ouvrier.
Durée de l’engagement
Pour le reste, le Code civil contient une seule disposition relative au contrat de travail : l’article 1780, toujours en vigueur, qui prévoit qu’« on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée ». Telle que formulée, cette disposition semble protéger le travailleur : on peut aliéner sa liberté en s’engageant à obéir à un patron, mais cet engagement est révocable, par opposition à d’autres sujétions qui ont existé en d’autres temps et existent toujours en d’autres lieux. Mais en réalité, il a toujours été admis que la règle fonctionnait à double sens : l’employeur non plus ne peut pas s’engager à occuper un travailleur à vie. Il est possible de renforcer par convention (individuelle ou collective) la protection légale du licenciement (« clauses de stabilité d’emploi »), mais pas au point d’empêcher l’employeur de licencier, ni même de rendre le licenciement tellement onéreux que l’employeur serait contraint d’y renoncer. Il est vrai que cette interprétation ne se prévaut pas uniquement d’une exégèse du Code. On invoque aussi rien moins que les Droits de l’Homme (ah ! les Droits de l’Homme !), en l’occurrence la liberté du travail. Mais il est piquant (et symptomatique) de constater que, dans le sens qui semblait dicté par le Code civil (le droit du travailleur de quitter unilatéralement l’employeur), le droit en vigueur a longtemps été plus restrictif.
Bonjour le prolétariat
Car on commettrait une erreur fondamentale de perspective (pourtant souvent commise par la Vulgate) en croyant qu’en dehors du Code civil, le droit belge était muet sur la question du contrat de travail, même avant les premières lois sur la protection contre le blanc de céruse ou le travail des enfants de moins de 12 ans au fond de la mine. Si le Code civil s’intéressait moins au contrat de travail qu’aux héritages, à la vente ou aux baux, ce n’est pas parce que le législateur s’en désintéressait, ni même, comme on l’a dit, parce que la France de Napoléon n’avait pas encore été touchée par la Révolution industrielle. C’est, tout simplement, qu’on considérait que la législation spécifique du travail était satisfaisante, et n’avait pas besoin d’être reprise dans le Code civil. Ce choix fut moins unanime et indiscuté qu’on ne le dit généralement. Ce qu’on peut appeler l’aile gauche du parlement avait plaidé pour faire de l’ouvrier un réel partenaire contractuel de l’employeur. Et si le choix contraire a été fait, c’est parce qu’on a considéré que l’ouvrier n’avait ni l’éducation ni le discernement qui lui permettraient d’assumer réellement un rôle économique autonome. On l’a dès lors assujetti à un droit spécifique qui assurait le pouvoir de l’employeur, et qui, bien davantage que la liberté, caractérisait réellement la « condition de prolétaire ». Les éléments de cette réglementation, qui non seulement ne faisait pas partie du Code civil, mais dérogeait même à sa logique profonde, méritent d’être rappelés.
Le livret ouvrier
Il y avait d’abord le livret ouvrier. Le livret ouvrier était une sorte de permis de travail pour autochtones. Comme le permis de travail, c’était un document indispensable pour pouvoir travailler comme ouvrier. À la différence du permis de travail moderne, le livret ouvrier n’était cependant pas une sorte de document d’identité. Il s’apparente plutôt au livret militaire, dont il était d’ailleurs inspiré. Pendant la relation de travail, il était détenu par l’employeur. Celui-ci avait le pouvoir de le retenir si le travailleur quittait l’entreprise sur un désaccord. En somme, comme le livret militaire, le livret ouvrier voulait dépister les déserteurs et les insoumis. Le but premier de l’institution était d’empêcher les ouvriers d’« abuser » de la liberté contractuelle offerte par le Code civil, y compris l’article 1780 déjà cité, pour quitter leur employeur au profit d’une embauche mieux payée.
La liberté d’association
Au nom de la liberté contractuelle, la fameuse loi Le Chapelier interdisait les « coalitions ouvrières », c’est-à-dire les ententes, structurées ou non, permanentes ou non, en vue de peser collectivement sur les salaires. De telles coalitions ne viciaient pas seulement le contrat conclu sous leur « contrainte » : elles étaient punies par le Code pénal. Les « coalitions d’employeurs », par contre, autrement dit les ententes diverses, formelles ou informelles, entre employeurs, n’étaient pas aussi systématiquement interdites. Il est notoire que des « ententes sur les prix » étaient conclues entre employeurs au sein des associations sectorielles et des chambres de commerce et d’industrie.
La loi Le Chapelier n’avait pas été votée par le Parlement belge. Comme le Code civil et la plupart des lois en vigueur en Belgique au moment de son indépendance, c’était un vestige de la période où les provinces belges étaient des départements français. Il y aurait eu un excellent motif de la considérer comme caduque en Belgique : la Constitution belge de 1831, qui garantissait la liberté d’association, sans établir d’exception en ce qui concerne les associations destinées à la défense collective des droits des travailleurs. Ce n’est qu’en 1921 que la législation belge a enfin concrétisé ce principe constitutionnel, par une loi garantissant la liberté d’association, y compris au niveau des syndicats. La création de syndicats est libre ; tout le monde est libre de s’affilier à un syndicat, dans les seules limites des statuts de celui-ci ; nul ne peut être obligé de le faire.
Le règlement d’atelier
Des éléments importants de la relation de travail n’étaient pas fixés par le contrat. On se rappellera que celui-ci était, à l’époque plus encore qu’aujourd’hui, verbal, et cette technique contractuelle se prête mal à des clauses sophistiquées. Le mesurage du travail, les horaires de travail, les motifs graves de rupture du contrat et autres sanctions disciplinaires, la durée des préavis, étaient fixés par le « règlement d’atelier », ancêtre des règlements de travail d’aujourd’hui. Le règlement d’atelier était établi et modifié unilatéralement par l’employeur. Celui-ci avait donc non seulement la capacité économique, mais aussi le pouvoir juridique, de modifier unilatéralement des éléments essentiels de la relation de travail. Il s’agit d’une dérogation aux mécanismes ordinaires du Code civil.
Un bailleur peut agiter la menace économique de ne pas renouveler le bail pour imposer au locataire une hausse de loyers. L’ouvrier ne pouvait même pas rompre le contrat aux torts de l’employeur s’il était en désaccord avec la modification du règlement d’atelier. Cette caractéristique a été conservée par les règlements de travail d’aujourd’hui, qui ont par ailleurs conservé plusieurs compétences des anciens règlements d’atelier. Mais il faut dire que le contexte a considérablement changé. D’une part, le règlement de travail n’est plus établi unilatéralement par l’employeur. La procédure prévoit un droit d’expression des travailleurs, un contrôle de l’inspection du travail, et un rôle d’arbitrage à la commission paritaire. D’autre part, la pratique des contrats écrits est beaucoup plus répandue qu’à l’époque, et il est permis de déroger au règlement de travail par une clause contractuelle soumise, conformément au Code civil, au principe de l’immutabilité des conventions. Et surtout, les principales prérogatives du règlement de travail (notamment l’horaire de travail et les préavis) sont étroitement encadrées par un droit impératif, protecteur du travailleur, établi par la loi et la réglementation, ou par des conventions collectives.
Les prud’hommes
Et enfin, pour surveiller tout cela, fonctionnaient des juridictions d’exception : les conseils de prud’hommes. Il est classique de voir dans les conseils de prud’hommes les ancêtres des actuels tribunaux du travail, et c’était en effet le cas des juridictions qui fonctionnaient sous ce nom à la veille de la réforme judiciaire, en 1971. Mais les conseils de prud’hommes du 19e siècle présentaient des caractéristiques très différentes de leurs homonymes du 20e et des actuels tribunaux du travail. Ces derniers sont présidés par un magistrat de carrière, nommé selon les critères habituels de nomination dans la magistrature. Il comprend également un nombre égal d’assesseurs, présentés respectivement par le patronat et par les syndicats. Il est compétent pour l’ensemble du contentieux civil dans les matières sociales. Les « prud’hommes » étaient à l’origine des juges non professionnels, nommés sur présentation du patronat, du personnel de maîtrise et des « ouvriers patentés », c’est-à-dire indépendants. Ils étaient assistés d’un « assesseur juridique », dont le rôle était de transcrire la sentence en termes juridiques. Les ouvriers salariés tombaient sous leur juridiction, mais n’étaient pas représentés dans le siège. Les conseils de prud’hommes avaient des compétences plus limitées que les tribunaux du travail actuels mais, contrairement à ces deniers, ils avaient aussi une compétence pénale, dans le domaine des secrets de fabrication. Leur rôle premier et avoué était d’empêcher les ouvriers d’« abuser » de la liberté contractuelle en vendant au plus offrant le know-how acquis dans leurs divers emplois.
Paul Palsterman