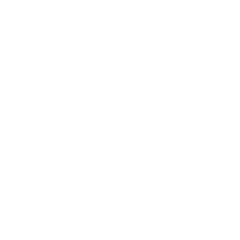Après la signature de l’accord interprofessionnel 2007-2008, le 21 décembre dernier, le Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (Carhop) offre ici l’occasion d’un regard rétrospectif sur un siècle et demi de relations collectives de travail. Une histoire loin d’être linéaire, et qui dit aussi comment le droit de négocier collectivement face aux employeurs a dû s’acquérir de haute lutte.
Au 19e siècle, les relations et les conflits entre les travailleurs et les patrons tournent pratiquement toujours à l’avantage de ces derniers. Détenteurs des capitaux et des moyens de production, ils dirigent leur entreprise avec pour seul objectif, la rentabilité. La principale victime de cette politique est le travailleur, dont les patrons se soucient fort peu. C’est un « outil » et, comme le remarque en 1843 le journaliste et directeur de l’administration des prisons, Édouard Ducpétiaux, « lorsque l’outil est ébréché, on le rejette, lorsque l’instrument est usé, on le remplace. » Dans un premier temps, l’ouvrier, exploité, semble frappé d’inertie. Il subit son sort sans y trouver à redire. L’inorganisation de la classe ouvrière due notamment à sa dispersion dans des cellules de travail réparties sur des territoires que l’urbanisation n’a pas encore touchés, le fatalisme ambiant dans lequel elle vit, et la position dominante du patronat renforcée par l’absence d’une législation sociale sont autant de facteurs qui expliquent cette apathie. Et quand bien même une réaction ouvrière se dessine, elle est rapidement dissoute. L’État y contribue grâce à quelques armes juridiques. Ainsi l’article 310 du Code pénal n’interdit certes plus les associations de personnes, mais sanctionne bel et bien leur action en cas de grève. Peines de prison et/ou amendes sont donc le lot de tous ceux qui tenteront d’obtenir gain de cause auprès du patron par voie de grève.
Au fil des décennies, l’industrialisation se développe. Les entreprises prennent des proportions de plus en plus importantes. La concentration ouvrière suit un chemin parallèle, ce qui facilite l’introduction et la diffusion des idées progressistes. Avec le réveil de la conscience ouvrière, les revendications se font plus précises. Mais face à l’intransigeance patronale, le dialogue semble impossible et la grève reste la seule arme que détient le prolétariat.
Les grèves tragiques de 1886 dans les bassins industriels wallons incitent cependant les acteurs politiques et économiques à se pencher enfin sur la question sociale. La Commission du travail s’attèle à la tâche très lourde d’entendre, d’analyser et de proposer des améliorations à cette condition. Les relations de travail font l’objet d’un questionnaire précis. Les avis sont partagés. Pour certains, la confiance doit être de mise entre patrons et travailleurs ; pour d’autres, et plus particulièrement les représentants des travailleurs, c’est loin d’être le cas dans les faits. Dès lors, comment concilier les deux parties lorsqu’une difficulté se présente ? Là encore les opinions divergent. Certains renvoient au conseil des Prud’hommes. Mais ce renvoi se heurte à une critique : le conseil n’intervient qu’en cas de conflit déclaré et n’a pas de fonction préventive. D’autres intervenants, rares, évoquent la possibilité d’un syndicat mixte (patrons et travailleurs). Mais comment réaliser une telle association lorsque la grande majorité des patrons ne veut tout simplement pas entendre parler de syndicat, quelle que soit sa forme ?
Ces débats mettent néanmoins en avant la nécessité d’un lieu de conciliation et d’arbitrage. En 1887, la loi créant les conseils de l’industrie et du travail est ainsi votée. Organisée par section d’industrie, cette institution a une double fonction : à la fois de prévention des conflits et de consultation auprès du gouvernement. Mais, après plusieurs années d’existence, force est de constater le peu d’impact réel de ces conseils. En fait, avec l’émergence d’un mouvement syndical mieux structuré, le nombre de conflits tend à augmenter. Le patronat répond aux revendications ouvrières par une résistance dure. Il n’hésite pas à employer l’arme du lock-out (fermeture provisoire d’une entreprise, décidée par l’employeur pour répondre à un conflit collectif, notamment en cas de grève partielle) et/ou à recourir à la force publique pour mettre un terme à une action des travailleurs.
Malgré l’échec pour les travailleurs qui solde la plupart des conflits, des avancées locales sont observées. Au début du 20e siècle, certains mouvements sociaux aboutissent ainsi à la signature d’une « convention collective de travail ». Celle-ci constitue une première étape vers la future reconnaissance du fait syndical. Un exemple : en novembre 1906, après un conflit qui toucha pas moins de 15 500 travailleurs, les syndicats ouvriers et les industriels du textile de Verviers signent une déclaration conjointe reconnaissant aux employeurs le droit de gérer leur entreprise comme ils l’entendent, d’une part, et créant, d’autre part, une commission mixte de conciliation pour débattre des points ayant trait aux conditions de travail, de salaire…
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le principal souci du gouvernement d’union nationale est de relancer l’économie. En 1918, le discours du trône d’Albert Ier souligne l’importance de l’enjeu et avance la nécessité de certaines réformes revendiquées de longue date par le mouvement ouvrier. Une première étape est franchie en 1919 avec le suffrage universel masculin (un homme = une voix). Mais sur le plan social, on est loin du compte. La hausse des prix, la faiblesse des salaires, le taux de chômage alourdissent le climat social et entravent la reconstruction. Des mouvements de grèves éclatent. Le patronat refuse de rencontrer les représentants syndicaux malgré les appels du gouvernement. Ce dernier réagit en provoquant lui-même des rencontres. En avril 1919, le ministre de l’Industrie, du Travail et du Ravitaillement, le socialiste Joseph Wauters, installe une commission d’études pour la réduction du temps de travail dans les usines métallurgiques et une autre pour les mines. C’est l’avènement des commissions paritaires nationales. Elles n’ont cependant pas de statut légal et leur installation dépend de la bonne volonté des deux parties. Le climat social s’améliore malgré tout. En 1921, la loi sur les 8 heures est votée, suivie par la loi abolissant l’article 310 du Code pénal et celle garantissant la liberté syndicale. Avec cette initiative, les relations patrons-travailleurs prennent un nouveau tournant. Pour les syndicats, c’est une étape supplémentaire en direction de la reconnaissance.
Cette ambiance constructive ne dure qu’un temps. Après 1921, les commissions paritaires (au nombre de 11 en 1922) ne se réunissent plus. Le patronat se replie sur ses positions antérieures. La crise économique des années 1930 a des conséquences dramatiques sur la classe ouvrière : augmentation du chômage, baisse des salaires sans concertation préalable… La grève générale de 1932 dans la région de Mons-Borinage survient sans que les organisations syndicales ne puissent s’y préparer. C’est un échec. En plus de la politique patronale restrictive, des mesures gouvernementales drastiques touchent les travailleurs et aggravent la situation des chômeurs.
Par contre, l’espoir renaît en 1936. La crise se résorbe et on assiste à la relance de la production sans que les travailleurs ne bénéficient toutefois de cette reprise. Les organisations syndicales prennent alors les devants. Elles élaborent un cahier commun de revendications portant entre autres sur l’octroi de la première semaine de congés payés, des 40 heures de travail par semaine, et lancent une grève générale. Son succès aboutit à la création d’un organe national de consultation, la Conférence nationale du travail, et à la restauration des commissions paritaires. Les réformes demandées sont votées.
Le second conflit mondial remet en question le fragile équilibre établi après les événements de 1936. Ce sont donc de nouveaux défis qui attendent les acteurs socio-économiques à la sortie de la guerre. Durant l’occupation, des représentants des organisations syndicales et patronales se rencontrent clandestinement afin de préparer l’après-guerre et élaborent le projet d’accord de solidarité sociale (pacte social). Ce document contient les engagements mutuels de ces nouveaux partenaires, chacun se voyant déterminer ses droits et ses devoirs. Le pacte social prévoit entre autres la mise en place d’un système légal de collaboration paritaire entraînant de nombreux bouleversements.
Au niveau de l’entreprise, la revendication portant sur la reconnaissance d’une délégation syndicale dans les établissements comprenant au moins 20 travailleurs est adoptée. En 1948, les délégués, dûment mandatés pour mener des négociations avec la direction de leur entreprise, se voient assurés d’une protection légale. La même année, la loi sur l’organisation de l’économie autorise la création de conseils d’entreprise dans les lieux de travail occupant au moins cent travailleurs. Les compétences de ces conseils sont très larges : elles vont de la réglementation des conditions de travail à l’examen des bilans de l’entreprise. Un bémol s’impose cependant : cette instance n’a qu’un pouvoir de consultation et non de décision. Toute entreprise comptant au moins 50 travailleurs est également dotée d’un comité de sécurité et d’hygiène qui intervient dans le domaine de la santé et des risques sur le lieu de travail. En 1996, cet organisme connaîtra une modification intégrant la notion de « bien-être au travail » et recevra une nouvelle dénomination : Comité pour la prévention et la protection du travail.
Par ailleurs, les commissions paritaires organisées par secteur d’activité disposent à partir de 1945 d’un statut légal. Désormais, les partenaires auront la possibilité de demander au Ministère de rendre obligatoires, par le biais d’un arrêté royal, les conventions conclues. Quant aux premières élections sociales, qui ont pour mission de désigner les délégués des diverses instances, elles se mettent en place en 1950.
Sur le plan national, les avancées sont également nombreuses. À côté d’organes consultatifs comme le Conseil national du travail ou encore le Conseil central de l’économie, les organisations syndicales et patronales, s’appuyant sur le principe de la solidarité, franchissent une nouvelle étape en centralisant davantage le processus de négociation. Les accords sectoriels sont maintenus. Mais certains secteurs d’activité ne disposent pas des acquis dont bénéficient les autres. À partir de 1960, les partenaires sociaux se lancent dans l’élaboration d’accords interprofessionnels touchant l’ensemble des travailleurs. Ces accords conclus pour deux ans permettent l’étalement des acquis dans le temps et assurent au patronat une paix sociale durable.
Si, jusqu’en 1975, la conclusion de semblables accords ne pose guère de difficultés, les relations entre les partenaires vont se dégrader progressivement en raison des effets liés au choc pétrolier de 1973 et de la résurgence de la crise économique. Le patronat se montre peu enclin à accorder davantage de concessions et le consensus ne semble plus guère possible. Face à cette situation, l’État se positionne. Au début des années 1980, le gouvernement obtient les pouvoirs spéciaux et prend des mesures d’assainissement. C’est seulement en 1986 que reprendront, dans un climat difficile, les négociations interprofessionnelles. Malgré la conclusion de nouveaux accords, le mouvement syndical éprouvera de nombreuses difficultés à faire entendre sa voix auprès d’un patronat qui favorise de nouveau des négociations au sein de chaque entreprise.
Carhop
L’accord interprofessionnel 2007-2008 L’AIP conclu le 21 décembre 2006 dresse les lignes directrices suivantes pour les conventions collectives de travail (CCT) qui seront négociées au niveau sectoriel et qui concerneront quelque deux millions de travailleurs du secteur privé : • En matière de formation des salaires, l’AIP fixe une norme salariale indicative de 5 % (coût de l’inflation et des barèmes sociaux inclus) et une correction technique équivalant à 0,15 % du coût salarial total, via le non-versement par les employeurs, d’une partie du précompte professionnel (0,25 % du coût salarial total). En outre, l’AIP fixe une double hausse du revenu minimum interprofessionnel : 25 euros en avril 2007 et 25 euros en octobre 2008. En matière salariale, il s’agira également pour les CCT de tenir compte de la directive-cadre européenne sur les barèmes salariaux et, le cas échéant, de corriger ces derniers pour éliminer les inégalités entre hommes et femmes. Dans ce contexte, qui est aussi celui de l’année européenne de « l’égalité des chances pour tous » (plutôt que pour quelques-uns ?), l’AIP recommande des actions en faveur d’une plus grande diversité sur le lieu de travail, sans pour autant énoncer de mesures précises. • En matière de formation, les secteurs devront élaborer des pistes concrètes, soit pour intensifier les efforts consentis à hauteur d’une augmentation de 0,1 % de la masse salariale par an, soit pour accroître de 5 % le taux de participation aux formations. Tous les secteurs doivent poursuivre cet effort jusqu’à ce que soit atteint l’objectif général de 1,9 % de la masse salariale consacrée à la formation. On en est loin puisque, en 2005, c’est un minimum historique qui a été atteint : 1,02 %. Or, énoncé pour la première fois en 1998, l’objectif de 1,9 % avait été fixé à l’échéance de 2004 ! Les mesures proposées pour remédier à cet état de fait sont au nombre de quatre : adaptation des cotisations pour le fonds de formation sectoriel ; octroi d’un temps de formation par travailleur (sur une base individuelle ou collective) ; proposition de formations en dehors des heures de travail ; établissement de planning de formation collectif via le conseil d’entreprise. En termes de public visé par ces formations, l’AIP recommande d’accorder une attention particulière aux travailleurs âgés (plan de formation spécifique), aux travailleurs peu qualifiés, aux allochtones et aux femmes. Les métiers en pénurie (fonctions critiques) devront également faire l’objet d’efforts ciblés. Le congé-éducation payé fait l’objet de dispositions spécifiques pour l’année scolaire 2007-2008. Au-delà, il est précisé que les interlocuteurs sociaux devront formuler une proposition globale, pour juin 2007 au plus tard. Le principe qui l’inspirera sera la responsabilisation des secteurs. • La R&D (Recherche et développement) fait l’objet de longs développements, mais de concrétisations rares, en dehors de celle d’inscrire chaque année le thème de l’innovation à l’ordre du jour du conseil d’entreprise. • Dans le domaine de l’organisation et de la qualité du travail, l’AIP annonce que le Conseil national du travail élaborera des pistes en vue de simplifier et rendre plus transparentes les dispositions concernant le temps partiel. Il recommande aux secteurs d’élaborer un cadre collectif qui permette de tenir compte, pour la fixation des barèmes salariaux, de l’ancienneté d’un travailleur qui, à l’issue d’un contrat à durée déterminée ou de remplacement, est engagé chez le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, les secteurs concernés par le problème des faux indépendants doivent se concerter pour élaborer des critères spécifiques permettant de déterminer l’existence ou non d’un lien d’autorité entre le travailleur et l’employeur. L’accord contient en outre des mesures permettant la mise en œuvre du pacte des générations. Elles portent sur le crédit-temps, les jours assimilés, les métiers lourds et l’outplacement – que l’employeur qui licencie un travailleur de plus de 45 ans est obligé de lui offrir, ce dernier étant à son tour obligé d’y souscrire.
Au 19e siècle, les relations et les conflits entre les travailleurs et les patrons tournent pratiquement toujours à l’avantage de ces derniers. Détenteurs des capitaux et des moyens de production, ils dirigent leur entreprise avec pour seul objectif, la rentabilité. La principale victime de cette politique est le travailleur, dont les patrons se soucient fort peu. C’est un « outil » et, comme le remarque en 1843 le journaliste et directeur de l’administration des prisons, Édouard Ducpétiaux, « lorsque l’outil est ébréché, on le rejette, lorsque l’instrument est usé, on le remplace. » Dans un premier temps, l’ouvrier, exploité, semble frappé d’inertie. Il subit son sort sans y trouver à redire. L’inorganisation de la classe ouvrière due notamment à sa dispersion dans des cellules de travail réparties sur des territoires que l’urbanisation n’a pas encore touchés, le fatalisme ambiant dans lequel elle vit, et la position dominante du patronat renforcée par l’absence d’une législation sociale sont autant de facteurs qui expliquent cette apathie. Et quand bien même une réaction ouvrière se dessine, elle est rapidement dissoute. L’État y contribue grâce à quelques armes juridiques. Ainsi l’article 310 du Code pénal n’interdit certes plus les associations de personnes, mais sanctionne bel et bien leur action en cas de grève. Peines de prison et/ou amendes sont donc le lot de tous ceux qui tenteront d’obtenir gain de cause auprès du patron par voie de grève.
Au fil des décennies, l’industrialisation se développe. Les entreprises prennent des proportions de plus en plus importantes. La concentration ouvrière suit un chemin parallèle, ce qui facilite l’introduction et la diffusion des idées progressistes. Avec le réveil de la conscience ouvrière, les revendications se font plus précises. Mais face à l’intransigeance patronale, le dialogue semble impossible et la grève reste la seule arme que détient le prolétariat.
Les grèves tragiques de 1886 dans les bassins industriels wallons incitent cependant les acteurs politiques et économiques à se pencher enfin sur la question sociale. La Commission du travail s’attèle à la tâche très lourde d’entendre, d’analyser et de proposer des améliorations à cette condition. Les relations de travail font l’objet d’un questionnaire précis. Les avis sont partagés. Pour certains, la confiance doit être de mise entre patrons et travailleurs ; pour d’autres, et plus particulièrement les représentants des travailleurs, c’est loin d’être le cas dans les faits. Dès lors, comment concilier les deux parties lorsqu’une difficulté se présente ? Là encore les opinions divergent. Certains renvoient au conseil des Prud’hommes. Mais ce renvoi se heurte à une critique : le conseil n’intervient qu’en cas de conflit déclaré et n’a pas de fonction préventive. D’autres intervenants, rares, évoquent la possibilité d’un syndicat mixte (patrons et travailleurs). Mais comment réaliser une telle association lorsque la grande majorité des patrons ne veut tout simplement pas entendre parler de syndicat, quelle que soit sa forme ?
Ces débats mettent néanmoins en avant la nécessité d’un lieu de conciliation et d’arbitrage. En 1887, la loi créant les conseils de l’industrie et du travail est ainsi votée. Organisée par section d’industrie, cette institution a une double fonction : à la fois de prévention des conflits et de consultation auprès du gouvernement. Mais, après plusieurs années d’existence, force est de constater le peu d’impact réel de ces conseils. En fait, avec l’émergence d’un mouvement syndical mieux structuré, le nombre de conflits tend à augmenter. Le patronat répond aux revendications ouvrières par une résistance dure. Il n’hésite pas à employer l’arme du lock-out (fermeture provisoire d’une entreprise, décidée par l’employeur pour répondre à un conflit collectif, notamment en cas de grève partielle) et/ou à recourir à la force publique pour mettre un terme à une action des travailleurs.
Malgré l’échec pour les travailleurs qui solde la plupart des conflits, des avancées locales sont observées. Au début du 20e siècle, certains mouvements sociaux aboutissent ainsi à la signature d’une « convention collective de travail ». Celle-ci constitue une première étape vers la future reconnaissance du fait syndical. Un exemple : en novembre 1906, après un conflit qui toucha pas moins de 15 500 travailleurs, les syndicats ouvriers et les industriels du textile de Verviers signent une déclaration conjointe reconnaissant aux employeurs le droit de gérer leur entreprise comme ils l’entendent, d’une part, et créant, d’autre part, une commission mixte de conciliation pour débattre des points ayant trait aux conditions de travail, de salaire…
Sinueuse reconnaissance
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le principal souci du gouvernement d’union nationale est de relancer l’économie. En 1918, le discours du trône d’Albert Ier souligne l’importance de l’enjeu et avance la nécessité de certaines réformes revendiquées de longue date par le mouvement ouvrier. Une première étape est franchie en 1919 avec le suffrage universel masculin (un homme = une voix). Mais sur le plan social, on est loin du compte. La hausse des prix, la faiblesse des salaires, le taux de chômage alourdissent le climat social et entravent la reconstruction. Des mouvements de grèves éclatent. Le patronat refuse de rencontrer les représentants syndicaux malgré les appels du gouvernement. Ce dernier réagit en provoquant lui-même des rencontres. En avril 1919, le ministre de l’Industrie, du Travail et du Ravitaillement, le socialiste Joseph Wauters, installe une commission d’études pour la réduction du temps de travail dans les usines métallurgiques et une autre pour les mines. C’est l’avènement des commissions paritaires nationales. Elles n’ont cependant pas de statut légal et leur installation dépend de la bonne volonté des deux parties. Le climat social s’améliore malgré tout. En 1921, la loi sur les 8 heures est votée, suivie par la loi abolissant l’article 310 du Code pénal et celle garantissant la liberté syndicale. Avec cette initiative, les relations patrons-travailleurs prennent un nouveau tournant. Pour les syndicats, c’est une étape supplémentaire en direction de la reconnaissance.
Cette ambiance constructive ne dure qu’un temps. Après 1921, les commissions paritaires (au nombre de 11 en 1922) ne se réunissent plus. Le patronat se replie sur ses positions antérieures. La crise économique des années 1930 a des conséquences dramatiques sur la classe ouvrière : augmentation du chômage, baisse des salaires sans concertation préalable… La grève générale de 1932 dans la région de Mons-Borinage survient sans que les organisations syndicales ne puissent s’y préparer. C’est un échec. En plus de la politique patronale restrictive, des mesures gouvernementales drastiques touchent les travailleurs et aggravent la situation des chômeurs.
Par contre, l’espoir renaît en 1936. La crise se résorbe et on assiste à la relance de la production sans que les travailleurs ne bénéficient toutefois de cette reprise. Les organisations syndicales prennent alors les devants. Elles élaborent un cahier commun de revendications portant entre autres sur l’octroi de la première semaine de congés payés, des 40 heures de travail par semaine, et lancent une grève générale. Son succès aboutit à la création d’un organe national de consultation, la Conférence nationale du travail, et à la restauration des commissions paritaires. Les réformes demandées sont votées.
Le second conflit mondial remet en question le fragile équilibre établi après les événements de 1936. Ce sont donc de nouveaux défis qui attendent les acteurs socio-économiques à la sortie de la guerre. Durant l’occupation, des représentants des organisations syndicales et patronales se rencontrent clandestinement afin de préparer l’après-guerre et élaborent le projet d’accord de solidarité sociale (pacte social). Ce document contient les engagements mutuels de ces nouveaux partenaires, chacun se voyant déterminer ses droits et ses devoirs. Le pacte social prévoit entre autres la mise en place d’un système légal de collaboration paritaire entraînant de nombreux bouleversements.
Dans l’entreprise
Au niveau de l’entreprise, la revendication portant sur la reconnaissance d’une délégation syndicale dans les établissements comprenant au moins 20 travailleurs est adoptée. En 1948, les délégués, dûment mandatés pour mener des négociations avec la direction de leur entreprise, se voient assurés d’une protection légale. La même année, la loi sur l’organisation de l’économie autorise la création de conseils d’entreprise dans les lieux de travail occupant au moins cent travailleurs. Les compétences de ces conseils sont très larges : elles vont de la réglementation des conditions de travail à l’examen des bilans de l’entreprise. Un bémol s’impose cependant : cette instance n’a qu’un pouvoir de consultation et non de décision. Toute entreprise comptant au moins 50 travailleurs est également dotée d’un comité de sécurité et d’hygiène qui intervient dans le domaine de la santé et des risques sur le lieu de travail. En 1996, cet organisme connaîtra une modification intégrant la notion de « bien-être au travail » et recevra une nouvelle dénomination : Comité pour la prévention et la protection du travail.
Par ailleurs, les commissions paritaires organisées par secteur d’activité disposent à partir de 1945 d’un statut légal. Désormais, les partenaires auront la possibilité de demander au Ministère de rendre obligatoires, par le biais d’un arrêté royal, les conventions conclues. Quant aux premières élections sociales, qui ont pour mission de désigner les délégués des diverses instances, elles se mettent en place en 1950.
Au niveau national
Sur le plan national, les avancées sont également nombreuses. À côté d’organes consultatifs comme le Conseil national du travail ou encore le Conseil central de l’économie, les organisations syndicales et patronales, s’appuyant sur le principe de la solidarité, franchissent une nouvelle étape en centralisant davantage le processus de négociation. Les accords sectoriels sont maintenus. Mais certains secteurs d’activité ne disposent pas des acquis dont bénéficient les autres. À partir de 1960, les partenaires sociaux se lancent dans l’élaboration d’accords interprofessionnels touchant l’ensemble des travailleurs. Ces accords conclus pour deux ans permettent l’étalement des acquis dans le temps et assurent au patronat une paix sociale durable.
Si, jusqu’en 1975, la conclusion de semblables accords ne pose guère de difficultés, les relations entre les partenaires vont se dégrader progressivement en raison des effets liés au choc pétrolier de 1973 et de la résurgence de la crise économique. Le patronat se montre peu enclin à accorder davantage de concessions et le consensus ne semble plus guère possible. Face à cette situation, l’État se positionne. Au début des années 1980, le gouvernement obtient les pouvoirs spéciaux et prend des mesures d’assainissement. C’est seulement en 1986 que reprendront, dans un climat difficile, les négociations interprofessionnelles. Malgré la conclusion de nouveaux accords, le mouvement syndical éprouvera de nombreuses difficultés à faire entendre sa voix auprès d’un patronat qui favorise de nouveau des négociations au sein de chaque entreprise.
Carhop
L’accord interprofessionnel 2007-2008 L’AIP conclu le 21 décembre 2006 dresse les lignes directrices suivantes pour les conventions collectives de travail (CCT) qui seront négociées au niveau sectoriel et qui concerneront quelque deux millions de travailleurs du secteur privé : • En matière de formation des salaires, l’AIP fixe une norme salariale indicative de 5 % (coût de l’inflation et des barèmes sociaux inclus) et une correction technique équivalant à 0,15 % du coût salarial total, via le non-versement par les employeurs, d’une partie du précompte professionnel (0,25 % du coût salarial total). En outre, l’AIP fixe une double hausse du revenu minimum interprofessionnel : 25 euros en avril 2007 et 25 euros en octobre 2008. En matière salariale, il s’agira également pour les CCT de tenir compte de la directive-cadre européenne sur les barèmes salariaux et, le cas échéant, de corriger ces derniers pour éliminer les inégalités entre hommes et femmes. Dans ce contexte, qui est aussi celui de l’année européenne de « l’égalité des chances pour tous » (plutôt que pour quelques-uns ?), l’AIP recommande des actions en faveur d’une plus grande diversité sur le lieu de travail, sans pour autant énoncer de mesures précises. • En matière de formation, les secteurs devront élaborer des pistes concrètes, soit pour intensifier les efforts consentis à hauteur d’une augmentation de 0,1 % de la masse salariale par an, soit pour accroître de 5 % le taux de participation aux formations. Tous les secteurs doivent poursuivre cet effort jusqu’à ce que soit atteint l’objectif général de 1,9 % de la masse salariale consacrée à la formation. On en est loin puisque, en 2005, c’est un minimum historique qui a été atteint : 1,02 %. Or, énoncé pour la première fois en 1998, l’objectif de 1,9 % avait été fixé à l’échéance de 2004 ! Les mesures proposées pour remédier à cet état de fait sont au nombre de quatre : adaptation des cotisations pour le fonds de formation sectoriel ; octroi d’un temps de formation par travailleur (sur une base individuelle ou collective) ; proposition de formations en dehors des heures de travail ; établissement de planning de formation collectif via le conseil d’entreprise. En termes de public visé par ces formations, l’AIP recommande d’accorder une attention particulière aux travailleurs âgés (plan de formation spécifique), aux travailleurs peu qualifiés, aux allochtones et aux femmes. Les métiers en pénurie (fonctions critiques) devront également faire l’objet d’efforts ciblés. Le congé-éducation payé fait l’objet de dispositions spécifiques pour l’année scolaire 2007-2008. Au-delà, il est précisé que les interlocuteurs sociaux devront formuler une proposition globale, pour juin 2007 au plus tard. Le principe qui l’inspirera sera la responsabilisation des secteurs. • La R&D (Recherche et développement) fait l’objet de longs développements, mais de concrétisations rares, en dehors de celle d’inscrire chaque année le thème de l’innovation à l’ordre du jour du conseil d’entreprise. • Dans le domaine de l’organisation et de la qualité du travail, l’AIP annonce que le Conseil national du travail élaborera des pistes en vue de simplifier et rendre plus transparentes les dispositions concernant le temps partiel. Il recommande aux secteurs d’élaborer un cadre collectif qui permette de tenir compte, pour la fixation des barèmes salariaux, de l’ancienneté d’un travailleur qui, à l’issue d’un contrat à durée déterminée ou de remplacement, est engagé chez le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, les secteurs concernés par le problème des faux indépendants doivent se concerter pour élaborer des critères spécifiques permettant de déterminer l’existence ou non d’un lien d’autorité entre le travailleur et l’employeur. L’accord contient en outre des mesures permettant la mise en œuvre du pacte des générations. Elles portent sur le crédit-temps, les jours assimilés, les métiers lourds et l’outplacement – que l’employeur qui licencie un travailleur de plus de 45 ans est obligé de lui offrir, ce dernier étant à son tour obligé d’y souscrire.