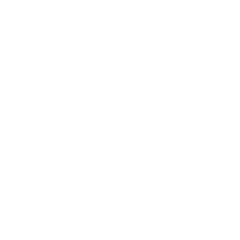Le vieillissement démographique et sociétal représente des enjeux cruciaux. À l’heure où se négocient durement les questions relatives aux fins de carrière, il semble plus que jamais nécessaire de resituer ce phénomène dans sa dimension historique. Car le vieillissement est loin d’être une évolution récente ou même un « accident», comme le pensent bon nombre de policitiens et de responsables. Ce phénomène multiséculaire fait partie des mutations globales des sociétés industrielles, comme la tertiarisation de l’économie ou la participation des femmes à l’emploi.
Il faut rappeler que le vieillissement n’a pas eu pour cause initiale le recul de la mortalité qui n’a profité au début de la révolution démographique qu’aux enfants en bas âge, mais bien le déclin de la natalité et de la fécondité, même si celui-ci répondait lui-même au mouvement de baisse de la mortalité infantile : la mort étant moins violente sur ce front des nouveaux nés, il était normal que les parents réagissent en adaptant à la baisse leurs comportements reproducteurs pour s’assurer une descendance survivante de la taille escomptée (effet d’assurance pour les « vieux jours »). Cependant, la conséquence inattendue de cette « dénatalité » fut un bouleversement, lent mais puissant, des structures de population par âge. C’est ainsi que le vieillissement qui jusque-là n’était qu’un phénomène individuel devint aussi un phénomène collectif, puisque ce terme désigna l’accroissement dans une population de la part des personnes âgées. Celle-ci augmenta en proportion parce que les jeunes diminuèrent en nombre. Moins d’enfants à la base de la pyramide des âges signifiait automatiquement plus de vieux au sommet (en pourcentages). Ainsi, alors qu’actuellement les personnes âgées de 65 ans et plus représentent plus de 15 % de la population totale, dans l’ancien régime démographique elles ne comptaient que pour moins de 5 %. Mais l’important est de rappeler que cette mutation s’est étalée dans les pays occidentaux sur 150 ou 200 ans, depuis les débuts de leur industrialisation (et même parfois plus tôt) jusqu’aujourd’hui, de sorte qu’on ne peut pas évoquer de nos jours que nous avons été surpris par cette évolution.
Ce qui a été sans doute plus surprenant, c’est le fait qu’une seconde cause du phénomène vieillissement démographique est venue renforcer la première, prenant en quelque sorte de vitesse même les experts en démographie qui durent revoir leur théorie. Jusqu’il y a quelques décennies, et tout au plus un demi-siècle, la mortalité n’avait pas été, en soi comme signalé plus haut, un facteur de vieillissement, mais plutôt de rajeunissement des structures par âge, parce que sa diminution contribuait surtout à maintenir en vie des enfants qui autrement seraient morts prématurément.
C’est pour cette raison que l’espérance de vie à la naissance a fortement progressé au XIXe siècle, passant d’un âge moyen au décès historiquement stable depuis l’origine de l’humanité, de l’ordre de 25 à 30 ans, à 50 ans vers 1900, du moins pour les pays les plus avancés (un peu plus tard pour la Belgique). Ce doublement historique a constitué une étape majeure de la grande révolution sanitaire et épidémiologique intervenue à l’aube du XXe siècle dans les pays en voie d’industrialisation. Mais on ne peut pas en déduire pour autant que la longévité de l’espèce humaine avait progressé, ou même que les personnes âgées vivaient réellement plus longtemps : simplement, puisque davantage d’enfants avaient échappé à la mort dans les premières années de la vie, d’avantage d’adultes arrivaient à des âges plus avancés qui étaient auparavant l’apanage d’un petit nombre de gérontes « chanceux » (1).
Du moins est-ce la situation qui prédomina jusqu’à pratiquement la première moitié du XXe siècle, période à partir de laquelle les progrès réalisés en matière de lutte contre la mortalité commencèrent à profiter essentiellement aux personnes âgées. Sinon, il n’y aurait plus eu de raison que l’espérance de vie continue à augmenter comme elle l’a fait, dans la mesure où les gains à réaliser du côté des enfants étaient devenus très faibles, avec des niveaux de mortalité infantile inférieurs à 10 pour mille (un décès d’enfant de moins d’un an pour 100 naissances).
Or, il faut rappeler qu’après le doublement de l’espérance de vie à la naissance intervenue au cours du XIXe siècle, le XXe siècle produisit encore un nouveau bond quantitatif avec une avancée supplémentaire de 30 ans, la longévité moyenne passant de 50 à 80 ans, avec toutefois un différentiel d’environ 5 ans en faveur des femmes (2). Concrètement cela signifie qu’il y a de plus en plus de personnes qui vivent de plus en plus longtemps, les octogénaires et les nonagénaires étant légion et les centenaires n’étant plus des cas exceptionnels.
Une longue lutte
C’est dans ce contexte démographique bouleversé qu’il convient d’examiner les autres évolutions sociétales. Car le vieillissement collectif ne s’est pas limité dans ses conséquences à sa dimension démographique. Il a essaimé dans la plupart des autres composantes fondamentales de nos sociétés, depuis la force de travail jusqu’à la transmission patrimoniale. Mais c’est sans doute dans le domaine de la protection sociale que les conséquences du vieillissement sont les plus visibles et les plus sensibles.
Au début du XXe siècle, la protection contre les grands risques de la vie était quasiment inexistante, qu’il s’agisse du risque maladie, du risque accident, du risque chômage ou du risque vieillesse. En matière de pension, seule existait la pension libre ou volontaire, et en 1913, à la veille de la première guerre mondiale, seulement 80 000 Belges s’étaient assurés en vue de la pension vieillesse, la plupart pour des montants assez dérisoires très en dessous de leurs besoins réels de subsistance (3) . En matière d’assurance contre la maladie et l’invalidité, les progrès avaient été moins lents, dans la mesure où tous les partis avaient soutenu depuis longtemps les efforts mutualistes, contrairement à l’hostilité générale qui empêchait « les caisses de retraites d’espérer le moindre développement », ce qui n’empêchait pas qu’à la veille de la première guerre les mutualités primaires ne regroupaient qu’un demi-million de membres affiliés.
Bien entendu, les faibles avancées dans ce domaine de la protection n’étaient pas dues, comme on l’évoquait souvent du côté des partis traditionnels, à l’imprévoyance des travailleurs et au « je m’enfoutisme » des ouvriers incapables de se préoccuper de sécuriser leur vieillesse mais à la faiblesse des salaires qui rendait irréaliste toute perspective d’épargne. De surcroît, les adversaires de l’instauration d’une assurance obligatoire mirent longtemps à jeter du lest et à abandonner les principes qu’ils privilégiaient de la « liberté subsidiée » de « l’effort individuel » et de « l’initiative personnelle ».
Il fallut attendre la fin du premier conflit mondial et le Traité de Versailles pour voir formulée l’obligation faite aux nations, « mues par des sentiments de justice et d’humanité aussi bien que par le désir d’assurer une paix mondiale durable », d’améliorer ou de réaliser des systèmes de pension de vieillesse et d’invalidité.
Des lois de pension pour les morts
En Belgique, c’est au ministre Wauters que revint le mérite de faire aboutir la revendication en 1920, mais la loi n’avait reçu l’accord des catholiques et des libéraux que pour une durée de 4 ans et un nouveau dispositif, moins large et moins audacieux, fut mis en place en 1924 à l’initiative du ministre Moyersoen. Il prévoyait une assurance partiellement obligatoire pour certains, mais facultative pour d’autres, et un âge d’accession à la pension de 65 ans. Resitué dans le contexte de mortalité de l’époque, il faut souligner que sur 100 000 naissances, d’après les tables de mortalité du moment, seulement 39 000 personnes pouvaient espérer atteindre l’âge de 65 ans, réduites même à 30 000 en ne prenant en compte que la population ouvrière (4).
Ce n’est donc pas par hasard que l’âge minimum de 65 ans pour bénéficier d’une pension (ou d’une pension complète) fut généralement retenu dans les pays européens : on raconte même que le chancelier Bismark, à qui on attribue la paternité des systèmes de retraite par répartition, avait au préalable consulté ses statisticiens pour fixer un âge à partir duquel le nombre de survivants n’aurait pas été trop élevé pour limiter le coût du financement nécessaire à l’instauration d’un régime de pension.
D’après des études de morbidité et de mortalité de l’époque basées sur des statistiques anglaises, sur 1 000 travailleurs âgés de 55 à 65 ans, 26 % mouraient avant l’âge limite de 65 ans s’ils relevaient du secteur agricole contre 39 % dans la population industrielle, avec des maxima pouvant atteindre 60 % dans le secteur des verreries et 75 % dans celui des poteries (5). Autrement dit, en fixant à 65 ans l’âge légal de la retraite, on courrait le risque de créer ce qu’on a parfois appelé une « loi de retraite pour les morts ».
Et c’est bien entendu ce qui a profondément changé de nos jours, depuis que la courbe des survivants des tables de mortalité récentes montre une tendance très nette à la rectangularisation. Autrement dit, les décès n’interviennent pratiquement plus (au sens statistique du terme) avant des âges avancés puisque sur 100 000 naissances pour chaque sexe, 81 400 d’hommes et 90 000 femmes survivent encore à 65 ans et ont respectivement une espérance de vie à cet âge de 16 et de 20 années (d’après les tables de mortalité belges de 2001).
La panique qui a saisi depuis quelques années les ministres des Pensions et la plupart des hommes politiques des pays européens est en grande partie due à cette montée en puissance des retraités et à la prolongation de leur survie jusqu’à des âges autrefois rarement atteints. Ce à quoi, il faut bien entendu ajouter, un ralentissement de la croissance économique qui contribue à réduire l’approvisionnement des caisses de retraite, à cause du chômage persistant à des taux élevés mais aussi à la stagnation des salaires et à la précarisation des carrières.
Une faille programmée
Manifestement le travail est en diminution dans une économie de plus en plus capitalistique et probablement faudrait-il accepter de revoir les modes de financement de la sécurité sociale qui avaient pourtant démontré leur efficacité pendant la majeure partie du XXe siècle, en le fondant principalement sur les cotisations salariales.
Dans ces conditions, est-il raisonnable de s’obstiner à colmater les brèches en proposant des mesures d’efficacité limitée (relevé des cotisations, abaissement des prestations, augmentation de la durée des carrières, etc.), alors qu’il conviendrait de proposer des réformes en profondeur, voire radicales, pour refonder la protection sociale sur des bases qui tiennent compte de l’environnement démographique contemporain mais aussi du contexte sociétal global ?
On sait en effet que l’évolution démographique va rendre la pression plus forte au cours de la prochaine décennie, à cause du rapport des générations qui évolue dans le sens d’une aggravation des taux de dépendance : les générations « pleines » du baby-boom (1945-1965) qui accèdent progressivement à la retraite à partir de 2005 vont devoir être supportées par les générations « creuses » du baby-flop qui leur ont succédé dans des conditions de carrière beaucoup moins favorables (précarité des emplois, temps partiel, chômage, stagnation des salaires).
Cette menace a suffi à provoquer la crainte de la faillite des systèmes de retraite et de santé et à encourager tous les adversaires du financement par la technique de la répartition à s’engouffrer dans la brèche pour proposer le démantèlement des régimes de pensions légales au profit de formules assurantielles, collectives ou privées, basées sur un principe de capitalisation. Généralement, les attaques ne sont cependant pas frontales, et les propositions ne consistent encore qu’à diversifier les fameux piliers, au nombre de trois : le pilier de la pension légale, le pilier facultatif de l’assurance groupe et le pilier assurantiel individuel (épargne-pension).
Ce qui n’est pas explicitement formulé dans ce qui paraît constituer une stratégie de bon sens, c’est que le renforcement des deuxième et troisième piliers a tendance à dévaloriser le premier – ou, en tout cas, à ne pas encourager son développement, et à exonérer les pouvoirs publics de leur obligation d’assurer aux retraités des conditions de vie correctes compatibles avec leur niveau antérieur de revenus. Or, les statistiques nous disent que le taux de remplacement des retraites varie en moyenne de 25 % pour les indépendants à 55 % pour les fonctionnaires, en passant par 35 % pour la grande masse des salariés, des performances qui sont loin d’être appréciables.
Pour une refondation radicale
De tels chiffres devraient suffire à démontrer la nécessité d’une réforme qui ne va pas forcément dans la direction de la privatisation du secteur, chère aux banquiers et aux assureurs, et depuis quelque temps aux hommes politiques déboussolés, mais au contraire dans celle du renforcement des solidarités intergénérationnelles qui découle du vieillissement de nos populations et du caractère plus multigénérationnel que jamais de nos sociétés postmodernes qui sont aussi les premières sociétés de la longévité et de la retraite.
Nos syndicalistes qui ont défendu dans le passé avec ardeur le principe de la pension obligatoire et qui ont aussi opté à l’époque des grandes avancées de la protection sociale pour le principe de la contribution ouvrière plutôt que pour celui de la gratuité des pensions, devraient peut-être se demander aujourd’hui si ce principe ne devrait pas être revu, pour les raisons évoquées plus haut. Des pistes existent, qui sont connues mais qui ont parfois été évoquées sans grand succès, comme la taxation du capital ou plus simplement le recours à l’impôt, ce qui aurait notamment pour avantage de réduire la pression sur les salaires et d’assurer une base contributive plus large à la protection sociale.
Pareille réforme donnerait peut-être le sentiment à certains de faire perdre au mouvement ouvrier et aux partenaires sociaux une partie de leur pouvoir traditionnel, mais elle aurait le mérite de répondre à une contrainte de notre temps qu’on pourrait formuler de la sorte : dans une société où l’enrichissement collectif se poursuit à un rythme soutenu et où le travail n’est plus le facteur principal d’accumulation, la protection généralisée et obligatoire des citoyens, qu’ils soient retraités, chômeurs, malades ou invalides, ne doit plus être assurée à travers des prélèvements effectués uniquement ou principalement sur la masse salariale, mais sur l’ensemble de la richesse produite.
Sinon, il y aura fort à craindre que la thèse de la privatisation s’impose de plus en plus dans un monde où l’individualisme triomphe et que le bel édifice de la protection sociale mis en œuvre par nos aïeuls s’effondre, faute d’avoir subi en temps opportun les ravalements que justifient les mutations de nos sociétés, mais sans sacrifier pour autant au principe essentiel de la solidarité entre les générations, les sexes et les catégories sociales qui reste une condition essentielle du maintien de la cohésion sociale.
(*) Carhop et UCL.
(1) C’est une constatation qui avait été faite relativement tôt puisqu’on peut lire dans la « Topographie médicale du Royaume de Belgique » (1910) les lignes suivantes : « La marque d’une plus grande longévité dans la population belge est manifeste. Aux deux extrêmes de la vie la mortalité a suivi une progression relative inverse. En un demi siècle, ou à peu près, on a constaté un abaissement de 30 % de mortalité dans la période des quinze premières années de la vie en regard d’une augmentation de 35 % aux âges opposés. Un plus grand nombre d’individus sont parvenus aux âges reculés. Le privilège de la longévité est sensiblement inégal entre les deux sexes ; il disparaît aux âges avancés bien moins d’hommes que de femmes. (…) La lutte et les soucis de la vie, et surtout l’intempérance, donnent pour la forte part la raison de cette moindre longévité chez l’homme. »
(2) En Belgique, en 2000, l’espérance de vie à la naissance était de 80,4 ans pour les femmes et de 75,1 ans pour les hommes.
(3) Sur les 80 000 rentiers en question âgés de 65 ans et plus, plus de 60 000 ne s’étaient constitué en 1913 que des rentes inférieures à 12 frs par an, alors que le salaire annuel moyen d’un ouvrier mineur était par exemple de 1 055 frs ou 3,5 frs par jour (cité dans J. Bondas, Les pensions de vieillesse, in Les Cahiers de la Commission syndicale de Belgique, n° 9, déc. 1926).
(4) cité par J. Bondas, op . cit., p. 4.
(5) op. cit., p. 20.