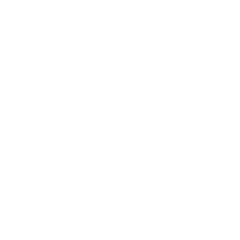En Europe, les partis de centre-gauche sont confrontés à l’achèvement d’un cycle idéologique et politique, écrit Ernst Hillebrand. Les projets de réformisme technocratique — style « troisième voie » et « nouveau centre » — ne sont plus capables de mobiliser suffisamment d’électeurs. Les partis du centre-gauche doivent donc, selon lui, formuler un nouveau projet politique, libéré de l’économisme qui a dominé les projets de réforme des années passées et qui puisse répondre aux nouveaux enjeux sociaux qui se sont développés les dernières années.
En Europe occidentale, les partis de centre-gauche sont en crise. Le nombre de pays où ils sont au pouvoir a nettement diminué depuis le milieu des années 1990. Ils ont perdu des élections, alors même que leur action au pou-voir a souvent été couronnée de succès (voir carte p. 6). Qua-tre pays scandinaves sur cinq — fiefs de la social-démocratie par excellence — sont actuel-lement gouvernés par un premier ministre conservateur. Il y a des raisons de penser qu’il ne s’agit pas là d’un simple mouvement de balancier, reflétant les aléas d’un électorat versatile, mais bien d’un défi fondamentalement nouveau. Le centre-gauche perd du terrain non seulement au profit de ses adversaires traditionnels du centre-droit, mais aussi, et de plus en plus, au profit de nouveaux partis populistes de droite (et dans certains cas, aus-si de gauche) 1. L’auteur de ces lignes est convaincu que cette situation marque la fin d’un cycle politique et idéologique : le projet centro-technocratique du type « troisième voie » en Grande-Bretagne, « nouveau centre » en Allemagne et « triangulation » à la Bill Clinton aux États-Unis, qui s’est imposé avec succès pendant les années 1990, a atteint ses limites et se révèle désormais politi-quement en partie dépassé. Ce projet se caractérisait par l’adaptation réus-sie des partis de centre-gauche aux nouvelles attentes des électeurs et à un contexte géopo-litique et économique qui avait fortement évo-lué depuis le milieu des années 1980. Il consti-tuait alors une interprétation congénitale du zeitgeist (esprit du temps) politique, permettant aux partis de centre-gauche de s’imposer en Europe comme la force politique dominante de la seconde moitié des années 1990.
Au fond, les différentes versions de ce projet se ressemblaient. Elles associaient des positions néolibérales modérées en matière économique et fiscale avec l’insistance sur un rôle actif de l’État et l’expression de points de vue progressistes en matière de culture et de valeurs. Ces dernières revêtaient une importance symbolique consi-dérable en tant que « preuves » du caractère authentiquement « progressiste » du projet. Des réformes du marché du travail et une diminu-tion des prestations sociales étaient accompagnées d’une réduction du caractère redistributif du système fiscal et d’une accélération des privatisations d’entreprises et de services pu-blics. Une priorité fut accordée à l’adaptation de l’économie et des systèmes sociaux à l’espace européen : construction du marché inté-rieur, politiques continentales de déréglemen-tation et de concurrence, monnaie unique, restrictions importantes imposées aux politi-ques industrielles et aux mesures pour attirer des investissements.
Les partis de centre-gauche se présentèrent alors à de nouvelles catégories d’électeurs issus des classes moyennes comme les « ges-tionnaires plus efficaces du capitalisme ». Le secteur de l’éducation fut dans le même temps, placé au centre du projet politique et chargé de missions qui allaient bien au-delà de l’interprétation classique du rôle de l’éducation. Celle-ci prenait le relai de la politique budgétaire redistributive de l’après-guerre et devenait le principal instrument de réforme ; investir dans l’éducation devait aussi permettre de régler à l’avenir des problèmes de justice sociale, de chômage et de compéti-tivité internationale.
La mondialisation et l’intégration euro-péenne (variation particulière de l’internationalisation propre à l’Europe) ont pesé de manière défavorable sur la situation économique des salariés européens. Les gouvernements de la « troisième voie » n’ont pratiquement rien pu y changer. Depuis 25 ans, la part des salaires dans le revenu national n’a cessé de diminuer au sein de l’Union européenne. Elle est passée de 72,1 à 68,4 %. Le nombre des actifs a dans le même temps considérablement augmenté, avec un taux d’activité passé de 61,2 % au milieu des années 1990 à 64,5 % aujourd’hui. Ce qui signifie en pratique qu’un nombre plus im-portant de travailleurs se partage un revenu relativement plus faible (voir tableau ci-dessous). La polarisation des revenus s’est nettement renforcée au cours de la même période : dans de nombreux pays d’Europe occidentale, l’indice de Gini des iné-galités sociales a augmenté depuis les années 1980. Ces évolutions ont eu tendance à décrédibiliser, auprès des milieux concernés, la principale promesse faite par la gauche réformiste : représenter les inté-rêts économiques et sociaux des « petites gens » plus efficacement que les autres partis grâce à une politique technocratique efficace et à des réformes « pragmatiques » du système.
Parallèlement, la deuxième réponse tradi-tionnelle du centre-gauche au changement économique — la promesse de création au sein de l’UE d’un espace économique, social et politique intégré et plus efficace — est de moins en moins bien acceptée par l’opinion publique. De nombreux Européens ont aujourd’hui une mauvaise image de l’Union, voire sont euros-ceptiques — et pas seulement en France ou aux Pays-Bas, où les référendums sur le traité constitutionnel européen ont échoué. Or cette réaction est loin d’être irrationnelle. Pendant que l’UE constitue une réussite formidable en tant qu’instrument de paix et de politique extérieure, son bilan en matière de croissance économique et de chô-mage est beaucoup plus faible. Michael Dau-derstädt parle à ce sujet de la « tragédie éco-nomique de l’intégration européenne ».
Les promesses de la « révolution de l’éducation » se sont, elles aussi, avérées relative-ment creuses. Les statistiques officielles esti-ment à 18,7 % le taux de chômage des jeunes en Europe. Mais on peut estimer qu’il est en réalité bien supérieur. Le potentiel d’intégration sociale des systèmes éducatifs ne s’est pas amélioré. Il s’est même plutôt dégradé. Le nombre de diplômés de l’enseignement se-condaire est ainsi resté quasiment stable de-puis 20 ans au sein de l’UE. En Allemagne, le nombre d’étudiants a augmenté seulement de 0,5 % ces dix dernières années. Le manque de ressources financières dont souffrent de nombreux systèmes éducatifs a nui à la qualité des diplômes universitaires et à leur valeur sur leur marché du travail. En même temps, les emplois se créent plus dans les secteurs de basse qualification de l’« économie des services » que dans des secteurs très rémunérateurs : dans les années 1990, la profession qui a connu la plus rapide croissance en Grande-Bretagne était celle de coiffeur. Et cela ne changera pas de si tôt : le gouvernement britannique estime en effet que 80 % des emplois qui seront créés d’ici à 2010 ne nécessiteront pas de formation uni-versitaire. En Eu-rope, les jeunes, même bien formés, ne sont pas seulement plus touchés par le chômage que la moyenne de la population, ils sont aussi plus fréquemment victimes de la pauvreté : 37 % des moins de 30 ans en Grande-Bretagne, 42 % en Allemagne et 49 % aux Pays-Bas sont statistiquement considérés comme « pauvres ».
De la même façon, le discours et l’attitude essentiellement passive de la gauche réfor-miste technocratique face à la mondialisation et à l’internationalisation — une sorte de version sociale-démocrate de la formule « TINA » de Mar-garet Thatcher (There is no alternative, « Il n’y a pas d’autre solution ») correspond de moins en moins à l’état d’esprit de la popula-tion. Laquelle attend de l’État national, un rôle beaucoup plus actif, voire combatif, que celui que la « nouvelle gauche » est prête à propo-ser jusqu’ici. Dans de nombreux pays s’observe actuellement la réapparition d’une sorte de nationalisme émotionnel, en contra-diction avec les discours en faveur de l’Europe et de la mondialisation préconisés par l’establishment de la gauche.
Certains signes suggèrent aussi qu’une évolution silencieuse des valeurs propres aux sociétés occidentales est en cours, sans que les partis de centre-gauche ne semblent la comprendre ou soient capables de l’utiliser sur le terrain politique. Dans certains pays, le zeitgeist semble à nouveau plus favorable au conservatisme ; les sondages font état d’une lente évolution en direction des valeurs traditionnelles et conservatrices. Le libéralisme et le relativisme socio-culturel qui caractérisent les sociétés « hédonistes » d’Occident (et aux-quels les réformateurs technocratiques sont si attachés en tant que preuve de leur « progressisme ») sont de plus en plus perçus comme problématiques, excessifs, voire socialement inadaptés. Politiquement, la droite s’empare de plus en plus de cet état d’esprit : au cours de sa campagne, Nicolas Sarkozy a fait une large place au « règlement de comptes » avec Mai 68. Aux États-Unis, les Républicains ont, sous la houlette de Karl Rove, construit leurs straté-gies électorales autour du « thème des valeurs », qui a laissé à plusieurs reprises les Démocra-tes hors jeu.
Dans de nombreux pays d’Europe occidentale, ces difficultés et ces contradictions ont éloigné des partis de centre-gauche une fraction im-portante de leur électorat traditionnel. C’est surtout avec les « cou-ches populaires » que le contact semble perdu. Les partis de centre-gauche ne parlent plus leur langage et ne partagent plus ni leurs in-quiétudes, ni leurs problèmes. En tant qu’organisation ou cadre de référence, les partis de centre-gauche sont désormais qua-siment absents des quartiers difficiles des nombreuses grandes villes européennes — et c’est dans cette brèche que s’engouffrent les nouveaux populistes de droite (et parfois aussi de gauche). Ces mouvements servent de plus en plus d’exutoires aux sentiments de frustra-tion et d’insatisfaction des milieux populaires marginalisés. Face au silence ou à l’embarras des partis de centre-gauche, les populations défavorisées se servent de ces mouvements populistes pour articuler leurs problèmes du quotidien.
À l’heure actuelle, les partis de centre-gauche sont visiblement désemparés face à la perte de crédibilité de leur discours technocratique auprès des électeurs auxquels ils ne semblent plus rien avoir à proposer qu’une adaptation sans appel au contexte économique, social et culturel « postmoderne ». Un des auteurs d’une étude de la Fondation Jean Jaurès sur les « couches populaires » en France cite à ce pro-pos, un habitant d’une banlieue qui déclare : « Ce n’est pas nous qui sommes dépolitisés. Ce sont les hommes politiques qui le sont » 3. Comme conséquence de ces développements se dessine pour la première fois depuis des décennies la possibilité de la rupture de l’alliance électorale sur laquelle repose la capaci-té des partis progressistes d’Europe à conqué-rir des majorités : l’alliance entre les couches populaires et une partie de la classe moyenne 4.
Ce nouveau projet doit en finir avec la stigma-tisation de certaines catégories de population (« les refuseurs de la modernisation », « les dé-fenseurs des acquis »). Et admettre plutôt que plusieurs évolutions de ces dernières années ont été néfastes pour une partie de la population : pertes de revenu, d’emploi, précarité croissante du travail, aliénation et déclin de la cohésion sociale dans des sociétés ethniquement et culturellement de moins en moins homogènes. Pressions de plus en plus fortes dans le monde du travail et exigence de mobili-té en hausse, avec des conséquences non négligeables pour la vie personnelle des indi-vidus. Lors d’une réunion à Londres, un ancien ministre social-démocrate suédois expliquait la défaite de son parti aux dernières élections en disant : We have talked about Sweden, not about Swedes (« Nous avons parlé de la Suède et non des Suédois »). Le centre-gauche ne saurait redevenir populaire sans ancrer à nouveau son discours dans la réalité du quoti-dien de son électorat. En même temps, il faut absolument se débar-rasser des tabous idéologiques qui caractéri-sent encore la gauche — principalement en matière d’immigration, le sujet par excellence sur lequel la gauche a refusé de regarder la réalité sociale en face. Ce déni a très forte-ment contribué à éloigner de la gauche euro-péenne, une partie de son électorat.
La gauche doit également clarifier son rapport à l’État national et à la question de l’identité nationale : beaucoup plus que les concepts du libéralisme, ce sont en effet les concepts de la gauche, fondés sur la solidarité mutuelle des « citoyens », qui ont besoin comme base d’une identité collective partagée. D’autant plus que c’est l’État national qui a été depuis un siècle le principal instrument dont s’est servie la gau-che pour mener à bien ses objectifs politiques et sociaux. Jusqu’à présent, elle n’a pas trouvé d’alternative à cet instrument. Beaucoup de gens aimeraient voir l’État jouer de nouveau un rôle plus actif. Mais en tant que « protecteur » et non en tant qu’exécutant de la mondialisation comme souvent sous les gouvernements de la « troisième voie ». Toute la difficulté consistera à défendre et revendiquer les bons côtés de l’État national tout en continuant à avancer sur la voie de l’intégration européenne. Cela impli-que que l’UE elle-même se montre plus active dans l’atténuation des aspects négatifs de la mondialisation.
Enfin, le centre-gauche doit aussi préciser à nouveau comment il entend utiliser sa marge de manœuvre politique dans l’intérêt de ses électeurs. Or, ces dernières années, ce sont surtout des sujets « légers » de type socio-culturels qui ont servi de cheval de bataille au centre-gauche. Simultanément, les sujets « lourds » — économie, fiscalité, institutions politiques — sont devenus un terrain quasiment interdit aux interventions politiques. Face à l’aggravation des inégalités et au blocage de l’ascenseur social pour les couches populaires et les classes moyennes, partout en Europe, on ne pourra en rester là 5.
Enfin, le centre-gauche doit aussi reprendre l’initiative sur les questions de société à plus long terme, sans se limiter à l’écologie (qui évidemment reste un sujet d’importance primordiale). S’il est vrai que les changements sociaux et économiques de « la modernité liquide » (Zygmunt Baumann) ont engendré, jusqu’au cœur des classes moyennes, des sentiments d’angoisse individuelle et collective, il n’en est pas moins clair que pour une grande partie de la population des pays occidentaux la « ques-tion sociale » peut être considérée comme ré-glée. Une vision politique purement économi-que, qui laisse de côté les questions touchant à la qualité de vie et à l’épanouissement indivi-duel et collectif, n’exerce qu’un attrait limité sur ces milieux. Le même constat s’impose face à une idéologie du « pessimisme social », pour utiliser une formule de Zaki Laïdi, centrée sur l’utopie négative du retour aux modèles des années 1960 et 1970 et qui interprète de façon exclusivement négative les changements éco-nomiques, sociaux et culturels de ces derniè-res décennies.
La stratégie de ce nouveau conservatisme lige consiste à ne plus remettre en question les objectifs du centre-gauche eux-mêmes — une certaine dose de sécurité sociale et de solidari-té, mais aussi une insistance sur le rôle de l’éducation et les droits des minorités. Mais de se différencier par les moyens d’y parvenir : pour les conservateurs, l’État est ainsi un instrument inadapté, trop coûteux et souvent trop lourd. Face à lui, le marché, le secteur privé et le bénévolat seraient plus efficaces.
Nous sommes au fond en présence d’une in-terprétation conservatrice du slogan avec le-quel le SPD a fait campagne contre Helmut Kohl en 1998 : « Nous ne ferons pas tout au-trement, mais il y a beaucoup de choses que nous ferons mieux ». C’est ce que promet la nouvelle droite « modérée » aujourd’hui : « Nous ne ferons pas tout autrement, mais il y a beau-coup de choses que nous ferons mieux — et pour moins cher ». Le centre-gauche n’a pas encore trouvé de réponse adéquate à ce défi. L’idée de voir pratiquer une politique économique et sociale similaire à celle de la gauche, mais sans ses pesanteurs idéologiques et culturelles semble séduire des électeurs issus de milieux les plus divers.
La contre-stratégie devra porter sur plusieurs fronts. Mais la question du rôle de l’État pour-rait bien revenir au premier plan. Nouvelle droite et nouvelle gauche se distinguent en effet tout de même sur ce point dans leur vi-sion de la société et du système social : quel rôle l’État devra-t-il jouer à l’avenir ? Dans la production de prestations sociales et de biens publics d’une part. Mais aussi pour offrir des chances d’épanouissement individuel ou col-lectif dans des sociétés de plus en plus mar-quées par les inégalités. Tout indique qu’en période d’incertitude croissante, la vision d’un État fort et actif séduit de plus en plus tous ceux qui redoutent la mise en place d’un sys-tème dans lequel les prestations du système social et éducatif échapperont au domaine des droits du citoyen et seront dès lors tributaires de l’arbitraire, du sélectif voire du caritatif d’un secteur privé et commercial. À une époque où les individus s’inquiètent de plus en plus pour leur existence et leur emploi, il devrait être possible de remporter cette bataille politique 6.
À la fin de l’ère mitterrandienne, Lionel Jospin avait tenté de revendiquer un « droit d’inventaire » pour la gauche française. C’est préci-sément d’un tel droit d’inventaire que la gau-che européenne doit maintenant faire usage à propos des projets de réformisme technocrati-que de la décennie passée. Un débat critique s’impose pour savoir ce qu’il faut en garder, ce qui ne correspond plus au contexte d’aujourd’hui, ce qui est dépassé et ce qui doit être remplacé par de nouvelles idées politiques. La bonne vieille vertu sociale-démocrate du révisionnisme réformiste doit être appliquée elle aussi face aux projets de la « troisième voie ».
(*) Ernst Hillebrand est directeur du bureau parisien de la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (institution allemande indépendante reconnue d’utilité publique, qui défend les idées et les valeurs fondamentales de la sociale-démocratie).
(1) C’est le cas non seulement en Italie (Forza Italia, MSI, Lega Norte) ou en France (Front national), mais également aux Pays-Bas (Liste Pim Fortyn), en Belgique (Vlaams Belang), en Autriche (FPÖ), au Danemark, en Suède et même d’une certaine façon au Royaume-Uni, où le Labour Party se montre inquiet pour les nationalistes du British National Party.
(2) En Grande-Bretagne, un sondage YouGov relatif aux priorités du gouvernement de Gordon Brown indique que pour 65 % de l’électorat et 53 % des électeurs du Labour, l’immigration est considérée comme le défi numéro un pour le nouveau premier ministre. Les mem-bres du parti travailliste ne sont en revanche que 20 % à considérer ce sujet comme prioritaire.
(3) Entretien avec Alain Mergier, Le Nouvel Observateur, n° 2206, 15 février 2007.
(4) Il ne faut toutefois pas se méprendre sur la nature politi-que de ce processus. Pour les électeurs des partis popu-listes, il ne s’agit pas de changer le système, mais d’en faire partie. Ce sont à bien des égards des « consomma-teurs ratés » (failed consumers, Zygmunt Bauman), des gens dont l’ambition principale est de participer pleine-ment, en tant que consommateurs à part entière, à la société (occidentale) moderne. Pour ces milieux qui se sentent marginalisés, ce sont moins les objectifs de la politique des partis établis qui posent problème, que leurs résultats, jugés négatifs ou insatisfaisants pour leur quoti-dien.
(5) L’inspiration pourrait venir de là où on ne l’espérait pas : aux États-Unis, le parti démocrate recommence pour la première fois depuis longtemps à débattre d’une politique de redistribution. Cf « Democratic hopeful push for new way beyond Clintonomics », Financial Times, 15 juin 2007.
(6) À propos du climat d’inquiétude sociale en Allemagne, voir aussi l’étude de la Fondation Friedrich-Ebert sur les milieux politiques en Allemagne (Neugebauer, 2007). http://www.fesparis.org/Website/site/accueil.htm.
En Europe occidentale, les partis de centre-gauche sont en crise. Le nombre de pays où ils sont au pouvoir a nettement diminué depuis le milieu des années 1990. Ils ont perdu des élections, alors même que leur action au pou-voir a souvent été couronnée de succès (voir carte p. 6). Qua-tre pays scandinaves sur cinq — fiefs de la social-démocratie par excellence — sont actuel-lement gouvernés par un premier ministre conservateur. Il y a des raisons de penser qu’il ne s’agit pas là d’un simple mouvement de balancier, reflétant les aléas d’un électorat versatile, mais bien d’un défi fondamentalement nouveau. Le centre-gauche perd du terrain non seulement au profit de ses adversaires traditionnels du centre-droit, mais aussi, et de plus en plus, au profit de nouveaux partis populistes de droite (et dans certains cas, aus-si de gauche) 1. L’auteur de ces lignes est convaincu que cette situation marque la fin d’un cycle politique et idéologique : le projet centro-technocratique du type « troisième voie » en Grande-Bretagne, « nouveau centre » en Allemagne et « triangulation » à la Bill Clinton aux États-Unis, qui s’est imposé avec succès pendant les années 1990, a atteint ses limites et se révèle désormais politi-quement en partie dépassé. Ce projet se caractérisait par l’adaptation réus-sie des partis de centre-gauche aux nouvelles attentes des électeurs et à un contexte géopo-litique et économique qui avait fortement évo-lué depuis le milieu des années 1980. Il consti-tuait alors une interprétation congénitale du zeitgeist (esprit du temps) politique, permettant aux partis de centre-gauche de s’imposer en Europe comme la force politique dominante de la seconde moitié des années 1990.
Au fond, les différentes versions de ce projet se ressemblaient. Elles associaient des positions néolibérales modérées en matière économique et fiscale avec l’insistance sur un rôle actif de l’État et l’expression de points de vue progressistes en matière de culture et de valeurs. Ces dernières revêtaient une importance symbolique consi-dérable en tant que « preuves » du caractère authentiquement « progressiste » du projet. Des réformes du marché du travail et une diminu-tion des prestations sociales étaient accompagnées d’une réduction du caractère redistributif du système fiscal et d’une accélération des privatisations d’entreprises et de services pu-blics. Une priorité fut accordée à l’adaptation de l’économie et des systèmes sociaux à l’espace européen : construction du marché inté-rieur, politiques continentales de déréglemen-tation et de concurrence, monnaie unique, restrictions importantes imposées aux politi-ques industrielles et aux mesures pour attirer des investissements.
Les partis de centre-gauche se présentèrent alors à de nouvelles catégories d’électeurs issus des classes moyennes comme les « ges-tionnaires plus efficaces du capitalisme ». Le secteur de l’éducation fut dans le même temps, placé au centre du projet politique et chargé de missions qui allaient bien au-delà de l’interprétation classique du rôle de l’éducation. Celle-ci prenait le relai de la politique budgétaire redistributive de l’après-guerre et devenait le principal instrument de réforme ; investir dans l’éducation devait aussi permettre de régler à l’avenir des problèmes de justice sociale, de chômage et de compéti-tivité internationale.
Nouveaux dilemmes
Pendant presque quinze ans, cette politique a permis aux partis progressistes de gagner des élections et de gouverner avec plus ou moins de succès. Mais aujourd’hui, les propositions de cette « gauche technocratique réformatrice » ne semblent plus suffisamment crédibles pour convaincre les électeurs. Trop de questions et de problèmes se sont avérés de plus en plus difficiles à résou-dre dans les marges de ce modèle.La mondialisation et l’intégration euro-péenne (variation particulière de l’internationalisation propre à l’Europe) ont pesé de manière défavorable sur la situation économique des salariés européens. Les gouvernements de la « troisième voie » n’ont pratiquement rien pu y changer. Depuis 25 ans, la part des salaires dans le revenu national n’a cessé de diminuer au sein de l’Union européenne. Elle est passée de 72,1 à 68,4 %. Le nombre des actifs a dans le même temps considérablement augmenté, avec un taux d’activité passé de 61,2 % au milieu des années 1990 à 64,5 % aujourd’hui. Ce qui signifie en pratique qu’un nombre plus im-portant de travailleurs se partage un revenu relativement plus faible (voir tableau ci-dessous). La polarisation des revenus s’est nettement renforcée au cours de la même période : dans de nombreux pays d’Europe occidentale, l’indice de Gini des iné-galités sociales a augmenté depuis les années 1980. Ces évolutions ont eu tendance à décrédibiliser, auprès des milieux concernés, la principale promesse faite par la gauche réformiste : représenter les inté-rêts économiques et sociaux des « petites gens » plus efficacement que les autres partis grâce à une politique technocratique efficace et à des réformes « pragmatiques » du système.
Parallèlement, la deuxième réponse tradi-tionnelle du centre-gauche au changement économique — la promesse de création au sein de l’UE d’un espace économique, social et politique intégré et plus efficace — est de moins en moins bien acceptée par l’opinion publique. De nombreux Européens ont aujourd’hui une mauvaise image de l’Union, voire sont euros-ceptiques — et pas seulement en France ou aux Pays-Bas, où les référendums sur le traité constitutionnel européen ont échoué. Or cette réaction est loin d’être irrationnelle. Pendant que l’UE constitue une réussite formidable en tant qu’instrument de paix et de politique extérieure, son bilan en matière de croissance économique et de chô-mage est beaucoup plus faible. Michael Dau-derstädt parle à ce sujet de la « tragédie éco-nomique de l’intégration européenne ».
Les promesses de la « révolution de l’éducation » se sont, elles aussi, avérées relative-ment creuses. Les statistiques officielles esti-ment à 18,7 % le taux de chômage des jeunes en Europe. Mais on peut estimer qu’il est en réalité bien supérieur. Le potentiel d’intégration sociale des systèmes éducatifs ne s’est pas amélioré. Il s’est même plutôt dégradé. Le nombre de diplômés de l’enseignement se-condaire est ainsi resté quasiment stable de-puis 20 ans au sein de l’UE. En Allemagne, le nombre d’étudiants a augmenté seulement de 0,5 % ces dix dernières années. Le manque de ressources financières dont souffrent de nombreux systèmes éducatifs a nui à la qualité des diplômes universitaires et à leur valeur sur leur marché du travail. En même temps, les emplois se créent plus dans les secteurs de basse qualification de l’« économie des services » que dans des secteurs très rémunérateurs : dans les années 1990, la profession qui a connu la plus rapide croissance en Grande-Bretagne était celle de coiffeur. Et cela ne changera pas de si tôt : le gouvernement britannique estime en effet que 80 % des emplois qui seront créés d’ici à 2010 ne nécessiteront pas de formation uni-versitaire. En Eu-rope, les jeunes, même bien formés, ne sont pas seulement plus touchés par le chômage que la moyenne de la population, ils sont aussi plus fréquemment victimes de la pauvreté : 37 % des moins de 30 ans en Grande-Bretagne, 42 % en Allemagne et 49 % aux Pays-Bas sont statistiquement considérés comme « pauvres ».
Nouveaus défis
Au cours de la même période, de nou-veaux défis sociaux sont apparus, face aux-quels la gauche n’avait pas de réponse appro-priée. L’exemple le plus frappant est celui de l’immigration, sujet qui n’a cessé de gagner en importance depuis quelques années. Le concept développé par la gauche face à l’arrivée massive de populations immigrées en Europe ces dernières décennies, celui d’une « société multiculturelle », a débouché sur un échec total. Le multiculturalisme, combiné avec l’absence de toute politique d’intégration active et systématique, s’est en effet soldé par l’apparition de sociétés fragmentées et de ghettos sociaux où aucune intégration ne s’est produite et où les frustrations réciproques des habitants de longue date et des immigrants se renforcent plutôt qu’elles ne s’apaisent. Notamment, les immigrés et leurs enfants sont les victimes du multiculturalisme qui les condamne à la marginalité économique, culturelle et so-ciale dans les pays où ils vivent. C’est surtout vrai des populations originaires de pays isla-miques, dont la deuxième et la troisième géné-ration sont parfois plus hostiles vis-à-vis des sociétés occidentales et de leurs valeurs que leurs parents. Pendant des années, la gauche a refusé tout débat sur les problèmes liés à l’immigration, en en faisant un véritable tabou. L’immigration est fort probablement le sujet sur lequel les militants et les dirigeants du centre-gauche se retrouvent aujourd’hui les plus éloi-gnés de l’opinion et des intérêts exprimés par leur électorat traditionnel 2.De la même façon, le discours et l’attitude essentiellement passive de la gauche réfor-miste technocratique face à la mondialisation et à l’internationalisation — une sorte de version sociale-démocrate de la formule « TINA » de Mar-garet Thatcher (There is no alternative, « Il n’y a pas d’autre solution ») correspond de moins en moins à l’état d’esprit de la popula-tion. Laquelle attend de l’État national, un rôle beaucoup plus actif, voire combatif, que celui que la « nouvelle gauche » est prête à propo-ser jusqu’ici. Dans de nombreux pays s’observe actuellement la réapparition d’une sorte de nationalisme émotionnel, en contra-diction avec les discours en faveur de l’Europe et de la mondialisation préconisés par l’establishment de la gauche.
Certains signes suggèrent aussi qu’une évolution silencieuse des valeurs propres aux sociétés occidentales est en cours, sans que les partis de centre-gauche ne semblent la comprendre ou soient capables de l’utiliser sur le terrain politique. Dans certains pays, le zeitgeist semble à nouveau plus favorable au conservatisme ; les sondages font état d’une lente évolution en direction des valeurs traditionnelles et conservatrices. Le libéralisme et le relativisme socio-culturel qui caractérisent les sociétés « hédonistes » d’Occident (et aux-quels les réformateurs technocratiques sont si attachés en tant que preuve de leur « progressisme ») sont de plus en plus perçus comme problématiques, excessifs, voire socialement inadaptés. Politiquement, la droite s’empare de plus en plus de cet état d’esprit : au cours de sa campagne, Nicolas Sarkozy a fait une large place au « règlement de comptes » avec Mai 68. Aux États-Unis, les Républicains ont, sous la houlette de Karl Rove, construit leurs straté-gies électorales autour du « thème des valeurs », qui a laissé à plusieurs reprises les Démocra-tes hors jeu.
Dans de nombreux pays d’Europe occidentale, ces difficultés et ces contradictions ont éloigné des partis de centre-gauche une fraction im-portante de leur électorat traditionnel. C’est surtout avec les « cou-ches populaires » que le contact semble perdu. Les partis de centre-gauche ne parlent plus leur langage et ne partagent plus ni leurs in-quiétudes, ni leurs problèmes. En tant qu’organisation ou cadre de référence, les partis de centre-gauche sont désormais qua-siment absents des quartiers difficiles des nombreuses grandes villes européennes — et c’est dans cette brèche que s’engouffrent les nouveaux populistes de droite (et parfois aussi de gauche). Ces mouvements servent de plus en plus d’exutoires aux sentiments de frustra-tion et d’insatisfaction des milieux populaires marginalisés. Face au silence ou à l’embarras des partis de centre-gauche, les populations défavorisées se servent de ces mouvements populistes pour articuler leurs problèmes du quotidien.
À l’heure actuelle, les partis de centre-gauche sont visiblement désemparés face à la perte de crédibilité de leur discours technocratique auprès des électeurs auxquels ils ne semblent plus rien avoir à proposer qu’une adaptation sans appel au contexte économique, social et culturel « postmoderne ». Un des auteurs d’une étude de la Fondation Jean Jaurès sur les « couches populaires » en France cite à ce pro-pos, un habitant d’une banlieue qui déclare : « Ce n’est pas nous qui sommes dépolitisés. Ce sont les hommes politiques qui le sont » 3. Comme conséquence de ces développements se dessine pour la première fois depuis des décennies la possibilité de la rupture de l’alliance électorale sur laquelle repose la capaci-té des partis progressistes d’Europe à conqué-rir des majorités : l’alliance entre les couches populaires et une partie de la classe moyenne 4.
Nouveau projet
Face à cette impasse, le centre-gauche doit s’atteler à formuler un nouveau projet politique et idéologique capable de convaincre des ma-jorités électorales. Ce projet doit se libérer de l’économisme réducteur des propositions de la « troisième voie », sans pour autant abandonner le terrain stratégique du « centre » social et politique. Certes, la solution n’est pas de reve-nir aux concepts des années 1970 et 1980, avec leur conception unilatérale de l’État social et de la « solidarité ». Les fondements sociaux et économiques sur lesquels ceux-ci reposaient ont probablement disparu pour toujours. Il s’agit bien plus de construire un discours poli-tique qui d’une part interprète correctement les espoirs et ambitions de la population — c’était l’une des grandes forces du projet de « nouveau centre » qu’il ne faut surtout pas abandonner —, mais qui réponde aussi à ses inquiétudes croissantes dans un monde de plus en plus complexe.Ce nouveau projet doit en finir avec la stigma-tisation de certaines catégories de population (« les refuseurs de la modernisation », « les dé-fenseurs des acquis »). Et admettre plutôt que plusieurs évolutions de ces dernières années ont été néfastes pour une partie de la population : pertes de revenu, d’emploi, précarité croissante du travail, aliénation et déclin de la cohésion sociale dans des sociétés ethniquement et culturellement de moins en moins homogènes. Pressions de plus en plus fortes dans le monde du travail et exigence de mobili-té en hausse, avec des conséquences non négligeables pour la vie personnelle des indi-vidus. Lors d’une réunion à Londres, un ancien ministre social-démocrate suédois expliquait la défaite de son parti aux dernières élections en disant : We have talked about Sweden, not about Swedes (« Nous avons parlé de la Suède et non des Suédois »). Le centre-gauche ne saurait redevenir populaire sans ancrer à nouveau son discours dans la réalité du quoti-dien de son électorat. En même temps, il faut absolument se débar-rasser des tabous idéologiques qui caractéri-sent encore la gauche — principalement en matière d’immigration, le sujet par excellence sur lequel la gauche a refusé de regarder la réalité sociale en face. Ce déni a très forte-ment contribué à éloigner de la gauche euro-péenne, une partie de son électorat.
La gauche doit également clarifier son rapport à l’État national et à la question de l’identité nationale : beaucoup plus que les concepts du libéralisme, ce sont en effet les concepts de la gauche, fondés sur la solidarité mutuelle des « citoyens », qui ont besoin comme base d’une identité collective partagée. D’autant plus que c’est l’État national qui a été depuis un siècle le principal instrument dont s’est servie la gau-che pour mener à bien ses objectifs politiques et sociaux. Jusqu’à présent, elle n’a pas trouvé d’alternative à cet instrument. Beaucoup de gens aimeraient voir l’État jouer de nouveau un rôle plus actif. Mais en tant que « protecteur » et non en tant qu’exécutant de la mondialisation comme souvent sous les gouvernements de la « troisième voie ». Toute la difficulté consistera à défendre et revendiquer les bons côtés de l’État national tout en continuant à avancer sur la voie de l’intégration européenne. Cela impli-que que l’UE elle-même se montre plus active dans l’atténuation des aspects négatifs de la mondialisation.
Enfin, le centre-gauche doit aussi préciser à nouveau comment il entend utiliser sa marge de manœuvre politique dans l’intérêt de ses électeurs. Or, ces dernières années, ce sont surtout des sujets « légers » de type socio-culturels qui ont servi de cheval de bataille au centre-gauche. Simultanément, les sujets « lourds » — économie, fiscalité, institutions politiques — sont devenus un terrain quasiment interdit aux interventions politiques. Face à l’aggravation des inégalités et au blocage de l’ascenseur social pour les couches populaires et les classes moyennes, partout en Europe, on ne pourra en rester là 5.
Enfin, le centre-gauche doit aussi reprendre l’initiative sur les questions de société à plus long terme, sans se limiter à l’écologie (qui évidemment reste un sujet d’importance primordiale). S’il est vrai que les changements sociaux et économiques de « la modernité liquide » (Zygmunt Baumann) ont engendré, jusqu’au cœur des classes moyennes, des sentiments d’angoisse individuelle et collective, il n’en est pas moins clair que pour une grande partie de la population des pays occidentaux la « ques-tion sociale » peut être considérée comme ré-glée. Une vision politique purement économi-que, qui laisse de côté les questions touchant à la qualité de vie et à l’épanouissement indivi-duel et collectif, n’exerce qu’un attrait limité sur ces milieux. Le même constat s’impose face à une idéologie du « pessimisme social », pour utiliser une formule de Zaki Laïdi, centrée sur l’utopie négative du retour aux modèles des années 1960 et 1970 et qui interprète de façon exclusivement négative les changements éco-nomiques, sociaux et culturels de ces derniè-res décennies.
La droite aussi se renouvelle
À toutes ces difficultés s’ajoute un défi supplémentaire : la droite aussi se modernise. Elle a abandonné, au moins dans sa rhétorique, le radicalisme néolibéral et tente avec succès de reconquérir le terrain politique du centre. Cette réorientation constitue aussi une reconnais-sance implicite de l’enracinement profond du projet politique du centre-gauche dans les sociétés occidentales. Ce « recentrage » des conservateurs peut être observé sous des formes diverses dans de nombreux pays : George W. Bush a remporté deux campagnes électorales en promettant un compassionate conservatism ; les conservateurs suédois menés par Fredrik Reinfeldt se sont engagés à maintenir l’État social à la suédoise et ont ainsi gagné les élections contre des sociaux-démocrates qui avaient pourtant fait leurs preuves dans la gestion des affaires d’État. Le CDU allemand, après une campagne « Angiemaniaque » qui a failli tourner au désastre, a renfilé des atours chrétiens-démocrates beaucoup plus traditionnels. En Grande-Bretagne, le parti conservateur a pris, sous la direc-tion de David Cameron, un époustouflant vi-rage à 180°. David Cameron se présente ainsi comme le défenseur de l’investissement pu-blic, du système public de santé britannique (le NHS), de l’environnement et du mariage ho-mosexuel. Le même constat s’impose pour la campagne électorale de Nicolas Sarkozy et l’ouverture de son gouvernement à des per-sonnalités de la gauche.La stratégie de ce nouveau conservatisme lige consiste à ne plus remettre en question les objectifs du centre-gauche eux-mêmes — une certaine dose de sécurité sociale et de solidari-té, mais aussi une insistance sur le rôle de l’éducation et les droits des minorités. Mais de se différencier par les moyens d’y parvenir : pour les conservateurs, l’État est ainsi un instrument inadapté, trop coûteux et souvent trop lourd. Face à lui, le marché, le secteur privé et le bénévolat seraient plus efficaces.
Nous sommes au fond en présence d’une in-terprétation conservatrice du slogan avec le-quel le SPD a fait campagne contre Helmut Kohl en 1998 : « Nous ne ferons pas tout au-trement, mais il y a beaucoup de choses que nous ferons mieux ». C’est ce que promet la nouvelle droite « modérée » aujourd’hui : « Nous ne ferons pas tout autrement, mais il y a beau-coup de choses que nous ferons mieux — et pour moins cher ». Le centre-gauche n’a pas encore trouvé de réponse adéquate à ce défi. L’idée de voir pratiquer une politique économique et sociale similaire à celle de la gauche, mais sans ses pesanteurs idéologiques et culturelles semble séduire des électeurs issus de milieux les plus divers.
La contre-stratégie devra porter sur plusieurs fronts. Mais la question du rôle de l’État pour-rait bien revenir au premier plan. Nouvelle droite et nouvelle gauche se distinguent en effet tout de même sur ce point dans leur vi-sion de la société et du système social : quel rôle l’État devra-t-il jouer à l’avenir ? Dans la production de prestations sociales et de biens publics d’une part. Mais aussi pour offrir des chances d’épanouissement individuel ou col-lectif dans des sociétés de plus en plus mar-quées par les inégalités. Tout indique qu’en période d’incertitude croissante, la vision d’un État fort et actif séduit de plus en plus tous ceux qui redoutent la mise en place d’un sys-tème dans lequel les prestations du système social et éducatif échapperont au domaine des droits du citoyen et seront dès lors tributaires de l’arbitraire, du sélectif voire du caritatif d’un secteur privé et commercial. À une époque où les individus s’inquiètent de plus en plus pour leur existence et leur emploi, il devrait être possible de remporter cette bataille politique 6.
À la fin de l’ère mitterrandienne, Lionel Jospin avait tenté de revendiquer un « droit d’inventaire » pour la gauche française. C’est préci-sément d’un tel droit d’inventaire que la gau-che européenne doit maintenant faire usage à propos des projets de réformisme technocrati-que de la décennie passée. Un débat critique s’impose pour savoir ce qu’il faut en garder, ce qui ne correspond plus au contexte d’aujourd’hui, ce qui est dépassé et ce qui doit être remplacé par de nouvelles idées politiques. La bonne vieille vertu sociale-démocrate du révisionnisme réformiste doit être appliquée elle aussi face aux projets de la « troisième voie ».
(*) Ernst Hillebrand est directeur du bureau parisien de la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (institution allemande indépendante reconnue d’utilité publique, qui défend les idées et les valeurs fondamentales de la sociale-démocratie).
(1) C’est le cas non seulement en Italie (Forza Italia, MSI, Lega Norte) ou en France (Front national), mais également aux Pays-Bas (Liste Pim Fortyn), en Belgique (Vlaams Belang), en Autriche (FPÖ), au Danemark, en Suède et même d’une certaine façon au Royaume-Uni, où le Labour Party se montre inquiet pour les nationalistes du British National Party.
(2) En Grande-Bretagne, un sondage YouGov relatif aux priorités du gouvernement de Gordon Brown indique que pour 65 % de l’électorat et 53 % des électeurs du Labour, l’immigration est considérée comme le défi numéro un pour le nouveau premier ministre. Les mem-bres du parti travailliste ne sont en revanche que 20 % à considérer ce sujet comme prioritaire.
(3) Entretien avec Alain Mergier, Le Nouvel Observateur, n° 2206, 15 février 2007.
(4) Il ne faut toutefois pas se méprendre sur la nature politi-que de ce processus. Pour les électeurs des partis popu-listes, il ne s’agit pas de changer le système, mais d’en faire partie. Ce sont à bien des égards des « consomma-teurs ratés » (failed consumers, Zygmunt Bauman), des gens dont l’ambition principale est de participer pleine-ment, en tant que consommateurs à part entière, à la société (occidentale) moderne. Pour ces milieux qui se sentent marginalisés, ce sont moins les objectifs de la politique des partis établis qui posent problème, que leurs résultats, jugés négatifs ou insatisfaisants pour leur quoti-dien.
(5) L’inspiration pourrait venir de là où on ne l’espérait pas : aux États-Unis, le parti démocrate recommence pour la première fois depuis longtemps à débattre d’une politique de redistribution. Cf « Democratic hopeful push for new way beyond Clintonomics », Financial Times, 15 juin 2007.
(6) À propos du climat d’inquiétude sociale en Allemagne, voir aussi l’étude de la Fondation Friedrich-Ebert sur les milieux politiques en Allemagne (Neugebauer, 2007). http://www.fesparis.org/Website/site/accueil.htm.