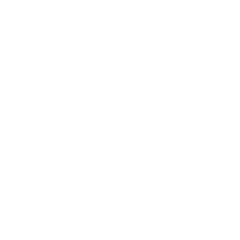Depuis le déclenchement de la crise de la dette souveraine fin 2010 et la déstabilisation de la zone euro, les gouvernements européens se sont lancés dans des politiques de rigueur et d’austérité sous la pression de l’Union européenne. Pour Christophe Degryse, chercheur à l’Institut syndical européen (ETUI), si cette résorption accélérée des déficits publics a permis de rassurer à court terme les marchés financiers, elle va plonger l’Europe dans la récession et ne répond pas aux véritables enjeux de la crise actuelle.
– Les plans d’austérité seraient aujourd’hui le prix à payer pour des années de négligence budgétaire. Il s’agit selon vous d’un mauvais diagnostic. Pourquoi ?
– Christophe Degryse : À l’exception de la Grèce qui est un cas tout à fait particulier et dont il faut éviter de tirer des leçons générales pour l’Europe entière, il est absolument faux de dire que l’indiscipline budgétaire des pays membres est à l’origine de la crise de la dette souveraine que nous connaissons aujourd’hui. Toutes les statistiques officielles montrent que de manière générale pendant les années 2000 les déficits publics ont été sous contrôle et que les dettes publiques étaient en voie de réduction tendancielle dans les pays membres de l’Union européenne.
– Et cette tendance était également à l’œuvre en Belgique ?
– C.D. : En effet, la Belgique a réduit sa dette publique de 46 points par rapport au PIB. Elle est passée de 130 % du PIB en 1995 à 84 % en 2007, juste avant la crise. Entre 2000 à 2007, ses déficits budgétaires ont été, en moyenne, de -0,37 % du PIB. À l’exception du cas grec, il n’y a donc pas eu de dérive générale des finances publiques qui justifierait le resserrement des règles budgétaires et l’austérité féroce imposée aujourd’hui à presque toute l’Europe. Ce qu’il y a eu, en revanche, c’est un sauvetage de l’industrie bancaire et financière, et un soutien à l’économie réelle pour éviter une grande dépression. S’il y a eu dérive, c’est d’abord et avant tout celle du secteur financier. Il faut le rappeler.
– Comment expliquer les mesures d’austérité imposées aujourd’hui ?
– C.D. : Suite à la crise de 2008, la dette a effectivement augmenté dans tous les pays pour les raisons que je viens d’évoquer. Mais on oublie un peu trop facilement de dire que la dette privée bancaire a été transférée à la dette publique gouvernementale. Si personne n’est pour une dette publique importante et des déficits publics qui explosent, ce qui pose problème aujourd’hui, c’est la rapidité, la brutalité et la simultanéité des programmes d’ajustement imposés dans les pays membres, en particulier à des pays comme l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande et évidemment à la Grèce. On demande aujourd’hui à cette dernière de réduire son déficit public dans des proportions et à une vitesse que l’on n’a jamais pu soutenir ailleurs dans l’histoire. C’est hallucinant. En outre, le fait que tous les pays de la zone euro ou presque s’engagent simultanément dans de tels programmes de rigueur et d’austérité a un effet récessif évident. La Commission européenne vient d’ailleurs de revoir ses prévisions économiques à la baisse, mais qui s’en étonne ? Au final, l’impression est que cette crise de l’endettement public est utilisée comme levier pour imposer des programmes de « réformes structurelles » tous azimuts, et tout particulièrement dans le domaine social. Un responsable du service d’étude du plus grand syndicat grec du secteur privé affirme que son pays est devenu le laboratoire du néolibéralisme le plus brutal qu’on ait jamais connu en Europe, comme cela fut le cas dans certains pays d’Amérique latine dans les années 1970 et 1980. Nous sommes entrés dans une Europe punitive qui a pour objectif prioritaire et presque exclusif de rassurer les marchés financiers.
– La zone euro est la seule zone économique attaquée de cette façon par les marchés financiers. Or, le niveau moyen de sa dette publique n’est pas plus élevé qu’aux USA, au Japon ou encore au Royaume-Uni. Comment expliquer ce paradoxe ?
– C.D. : Ce problème est lié à la construction inachevée de la zone euro. Au départ du traité de Maastricht qui préparait la monnaie unique, on a créé l’UEM, c’est-à-dire l’Union économique et monétaire. Si l’union monétaire a été mise en place dès l’instauration de l’euro, on n’a pas créé en parallèle d’union économique. Cela signifierait pour les États membres de s’engager dans une union plus politique que celle que l’on a aujourd’hui à travers notamment une harmonisation des politiques fiscales, une coordination des programmes d’investissements publics, une mutualisation des moyens de financement par des obligations européennes, voire une convergence en matière de politique salariale… des mesures dont ils n’ont pas voulu. Étant donné ce déséquilibre structurel, les marchés financiers spéculent sur les dettes souveraines de la zone euro et se demandent jusqu’à quel point la solidarité entre États membres va jouer. Surtout qu’à l’inverse des autres pays, les États membres de l’UE ne peuvent compter sur une Banque centrale agissant comme prêteur en dernier ressort. Un élargissement de la mission de la BCE qui permettrait de rassurer les marchés et de faire baisser la pression sur les État. Mais l’Allemagne refuse cette solution et il est sans doute illusoire de croire qu’elle va changer de position à court terme. Il faut donc trouver d’autres solutions et notamment réduire la dépendance des États par rapport aux marchés financiers.
– Le problème n’est-il pas alors qu’avec l’euro, les pays en difficulté avec leur dette ont peu de marge de manœuvre ?
– C.D. : En cas de crise économique, les États ont théoriquement plusieurs leviers d’action : la dévaluation monétaire, les stabilisateurs automatiques, la mobilité des travailleurs ou encore le coût du travail. En 1982, la Belgique, par exemple, a dévalué le franc belge pour donner un coup de fouet à son économie. Or, dans le cadre de la zone euro, la dévaluation est devenue impossible. De plus, avec des mesures comme le pacte budgétaire, les investissements publics sont en train d’être corsetés. Il ne reste donc que la mobilité et surtout la réduction des salaires comme variable d’ajustement. Le social est devenu la principale variable d’ajustement de la gestion de la crise.
– Vous indiquez que l’UE semble agir comme si la crise constituait une fenêtre d’opportunité pour imposer ses réformes et remettre en cause le modèle social en Europe. Le cas de la Belgique étant d’ailleurs emblématique.
– C.D. : Dans le cadre du système de gouvernance économique qui a été mis en place, la Belgique a reçu en 2011 pas moins de neuf recommandations européennes dans le domaine social, ce qui en fait l’un des pays les plus soumis à la pression de l’UE (voir graphique ci-dessus). Or, la Belgique est un des pays qui a le mieux résisté à la crise. Par rapport à d’autres pays, le chômage a relativement peu augmenté, tout comme le déficit public. Certes, la dette publique est au-dessus du seuil des 60 %, mais elle semble maîtrisée. Globalement, les indicateurs montrent que la Belgique s’en sort relativement bien, mais elle fait pourtant partie des cancres de la classe européenne selon le prisme de la nouvelle gouvernance de l’UE.
– Est-ce que cet agenda ultralibéral ne correspond pas au rapport de force politique actuel au sein de l’UE ?
– C.D. : Il est clair que le contexte politique européen n’a jamais été aussi favorable à la droite, que ce soit dans les États membres, au sein du Conseil de l’UE, au Parlement européen et à la Commission. Il y a évidemment un débat « gauche-droite » sur la nature des réformes mises en œuvre, et la gauche est minoritaire. Mais cette nouvelle gouvernance économique pose surtout un problème en terme démocratique. Toutes les décisions prises en 2011 pour sauver l’euro – il est vrai sous la pression des marchés financiers – l’ont été sans réel débat démocratique. Avec à sa tête le couple « Merkozy » qui a déterminé l’agenda européen comme jamais dans l’histoire de l’UE. C’est un réel problème, car beaucoup de mesures se veulent permanentes et gravées dans le marbre. Comme le cas emblématique de la « règle d’or » qui doit être inscrite dans les constitutions nationales. Si bien qu’il sera difficile en cas de changement du contexte économique ou politique de revenir sur ces décisions.
– Le mouvement syndical a toujours été favoralbe à plus de coordination des politiques économiques de l’UE rendue nécessaire par la monnaie unique. Quelle est sa position aujourd’hui ?
– C.D. : Historiquement le mouvement syndical a toujours soutenu l’intégration européenne, mais comme projet à la fois politique, économique et social. L’intégration politique pour garantir la paix à travers la construction d’un destin commun. L’intégration économique pour donner le moyen aux entreprises et à la vie économique en Europe de se développer. Et les syndicats n’ont jamais été contre cette nécessité. Mais aussi un projet social, visant à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble de ses citoyens. Or, aujourd’hui, la seule dimension qui semble compter pour l’UE est d’être compétitif sur les marchés internationaux avec des États membres se livrant une concurrence économique interne pour savoir qui va capter la plus grande part du gâteau sans se soucier des équilibres internes. C’est la première fois de son histoire que la Confédération européenne des syndicats (CES) a décidé de s’opposer à un traité européen en cours de négociation, le pacte budgétaire.
– Pourquoi ?
– C.D. : Simplement parce que ce pacte budgétaire reflète une vision totalement déséquilibrée de la construction européenne. L’émergence d’une Europe qui se limite à des mesures punitives pour renforcer les règles contraignantes du pacte de stabilité alors que l’on sait que ce n’est pas le problème fondamental. À l’inverse, très peu de choses ont été mises en place concernant le vrai problème, c’est-à-dire la gouvernance financière. Quatre ans après le déclenchement de la crise des subprimes, la Commission européenne vient seulement de décider de mettre en place un comité d’experts chargé de réfléchir à une éventuelle réforme de l’architecture bancaire en Europe ! On ne peut qu’être frappé par le contraste entre la vitesse de mise en œuvre des plans d’assainissement et l’extrême lenteur des mesures de régulation de l’industrie financière à l’origine de cette crise.
– Comment sortir de la crise ?
– C.D. : La seule manière de sortir de la crise est de combattre les inégalités qui en sont le point d’ancrage. Tous les indicateurs montrent que les inégalités s’accroissent dans tous les domaines : en matière de salaires, de revenus, de logement, d’éducation, etc. Plutôt que de s’attaquer à ce problème lié à une concentration outrancière des richesses d’une part, et à l’endettement de l’autre (ainsi qu’au pouvoir de plus en plus oppressant des marchés financiers), l’UE remet en cause tous les mécanismes institutionnels qui permettent de créer de l’égalité, comme la protection sociale, la négociation collective, ou encore le dialogue social. Des mécanismes qui ont fait pourtant largement leurs preuves au lendemain de la crise. L’Europe pense que l’on pourra sortir de la crise exclusivement par la compétitivité et la croissance en espérant que cette dernière sera ensuite équitablement répartie. Or, de plus en plus d’études montrent qu’aujourd’hui, quand la marée monte, elle ne monte plus pour tout le monde. Le « modèle » allemand tant vanté, avec pourtant l’augmentation des travailleurs pauvres, est à cet égard exemplatif et est en contradiction avec l’un des objectifs de la construction de l’UE, qui comme on peut le lire dans les traités, vise à l’« amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès ».
– Dans un premier temps, la crise a été considérée comme une opportunité pour préparer l’Union européenne à la transition vers une économie bas-carbone. Où en est-on aujourd’hui ?
– C.D. : On a tendance à l’oublier, mais au lendemain de la crise, la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion d’un développement durable avaient structuré les plans de relance économique des États membres. On pourrait parler de « keynésianisme climatique ». À partir de 2010, la priorité qui a été mise sur l’assainissement des finances publiques s’est couplée à celle de la croissance économique, sur laquelle comptent les gouvernements pour accélérer la résorption des déficits. Dans les textes officiels, on parle désormais de croissance durable et non plus de développement durable. Derrière les mots, il y a de nouveau une approche de la lutte contre le changement climatique qui fait une confiance absolue dans les mécanismes de marché pour orienter nos économies vers une société bas-carbone. Cette « utopie capitaliste », pour reprendre les termes de Newell et Paterson, est un pari très risqué sur la capacité des marchés à orienter les investissements nécessaires pour faire face au défi climatique. Or le chemin qui reste à parcourir pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 que s’est fixés l’UE est encore long.
– Ces objectifs sont-ils d’ailleurs atteignables dans un contexte d’austérité ?
– C.D. : Le « keynésianisme climatique » visait à donner des moyens d’action aux gouvernements pour lutter à grande échelle contre le réchauffement climatique. Parce que les gouvernements doivent se serrer la ceinture, on supprime ou on réduit dans certains États membres les primes pour les panneaux photovoltaïques, les primes à l’isolation… Selon le Fonds mondial pour la nature, les programmes d’austérité successifs entraînent une crise environnementale en Grèce. Le risque est donc aussi que l’UE prenne du retard dans les investissements nécessaires pour faire face au réchauffement climatique et perde l’avance qu’elle avait acquise.
– Qu’est-ce qui vous inquiète le plus dans le chemin pris actuellement par l’Union européenne ?
– C.D. : L’évolution actuelle a plusieurs aspects inquiétants. L’un des plus importants est de voir un divorce s’installer entre le monde du travail et l’idée européenne. Nous sommes dans la caricature des politiques visant à mettre sur les épaules les plus faibles le poids le plus lourd. La situation actuelle a mis en avant certaines lacunes de la construction européenne. La seule manière de sortir de cette crise est de faire avancer cette union politique, mais qui ne doit pas être simplement une union budgétaire punitive. Elle doit aussi être une union qui cherche une plus grande cohésion économique, sociale, qui mutualise une partie des dettes publiques via le mécanisme des euro-obligations, qui renforce la coordination des politiques fiscales et les différents régimes de sécurité sociale. L’UE doit progresser dans les politiques de redistribution et de « déconcentration » des richesses, et les politiques de protection sociale avec pour objectif de réduire les inégalités entre les États membres et à l’intérieur de ceux-ci.
– Cette évolution est-elle possible sans le renforcement en parallèle du mouvement syndical européen ?
– C.D. : Le mouvement syndical européen doit être un des acteurs clés de ce projet pour une Europe plus politique, dans le sens que je viens de décrire. Mais deux problèmes se posent : primo, les institutions européennes ont aujourd’hui tendance à vouloir marginaliser le mouvement syndical. Ainsi, le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a récemment déclaré à un journal financier américain que le modèle social européen était obsolète ! Secundo, il sera de plus en plus difficile de faire passer auprès des travailleurs le message de plus d’Europe politique dans le contexte de l’Europe punitive que l’on nous construit aujourd’hui. Et pourtant oui, le renforcement du mouvement syndical européen est aujourd’hui plus que jamais nécessaire pour faire vivre ce « destin désormais partagé » que nous promettait l’Europe des débuts, et qu’il est urgent de rappeler à la génération actuelle de dirigeants nationaux et européens.
1. Cette interview se base sur l’article «Les inquiétants chemins de la nouvelle gouvernance» par Christophe Degryse et Philippe Pochet. À paraître dans le prochain Bilan social de l’Union européenne publié par l’Observatoire social européen.
2. Déclaration de la CES sur le «Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’union économique et monétaire», 25 janvier 2012. Document disponible à l’adresse suivante: < ">http://www.etuc.org/a/9592>;.
Pacte budgétaire : constitutionnaliser l’Europe de l’austéritéDébut mars, 25 chefs d’États et de gouvernements européens signaient le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), communément appelé le pacte budgétaire. Le Royaume-Uni et la République tchèque se sont abstenus. Ce nouveau traité européen vise principalement à renforcer la discipline budgétaire dans les États membres par l’instauration de sanctions plus automatiques et une surveillance plus stricte des budgets nationaux. Il prévoit notamment l’établissement d’une «règle d’or budgétaire» à inscrire dans les constitutions ou législations nationales qui limite le déficit public structurel à un niveau maximal de 0,5% du PIB. Concrètement, cette mesure limitera les investissements publics qui sont indispensables au développement économique et au progrès social, et la possibilité pour les États de mener des politiques «contracycliques» de relance de l’économie en cas de récession. Il constitue un pas de plus vers l’institutionnalisation d’une Europe de l’austérité. Ce traité est aussi fortement critiqué pour le recul démocratique qui caractérise sa mise en oeuvre. Il consacre la méthode intergouvernementale au détriment de la méthode communautaire, ce qui a empêché un réel contrôle démocratique clair et transparent du processus. Alors même que tous les traités précédents avaient eu à coeur de réduire le déficit démocratique de l’UE à travers un rôle accru du Parlement européen. De plus, le carcan supplémentaire qu’impose ces nouvelles règles aux politiques budgétaires nationales risque non seulement d’être contre-productif d’un point de vue économique, mais limite la souveraineté des États membres sur l’élaboration de leur budget, acte politique majeur s’il en est. Ce traité doit maintenant être approuvé par les différents États membres pour être intégré à terme dans le traité de Lisbonne. Il entrera en vigueur quand au moins 12 États membres de l’Union européenne l’auront ratifié. En Belgique, le Parlement fédéral et les Parlements régionaux doivent encore se saisir du texte. Un traité élaboré dans la précipitation qui est de plus en plus contesté, car ne répondant pas aux véritables enjeux de la crise. La Confédération européenne des syndicats a indiqué qu’en ne ciblant que la rigueur budgétaire les propositions de ce traité allaient aggraver la crise et risquaient aussi d’affaiblir l’Europe plutôt que la renforcer 2. François Hollande, candidat socialiste à la présidentielle en France, a annoncé vouloir le renégocier s’il était élu... PT |